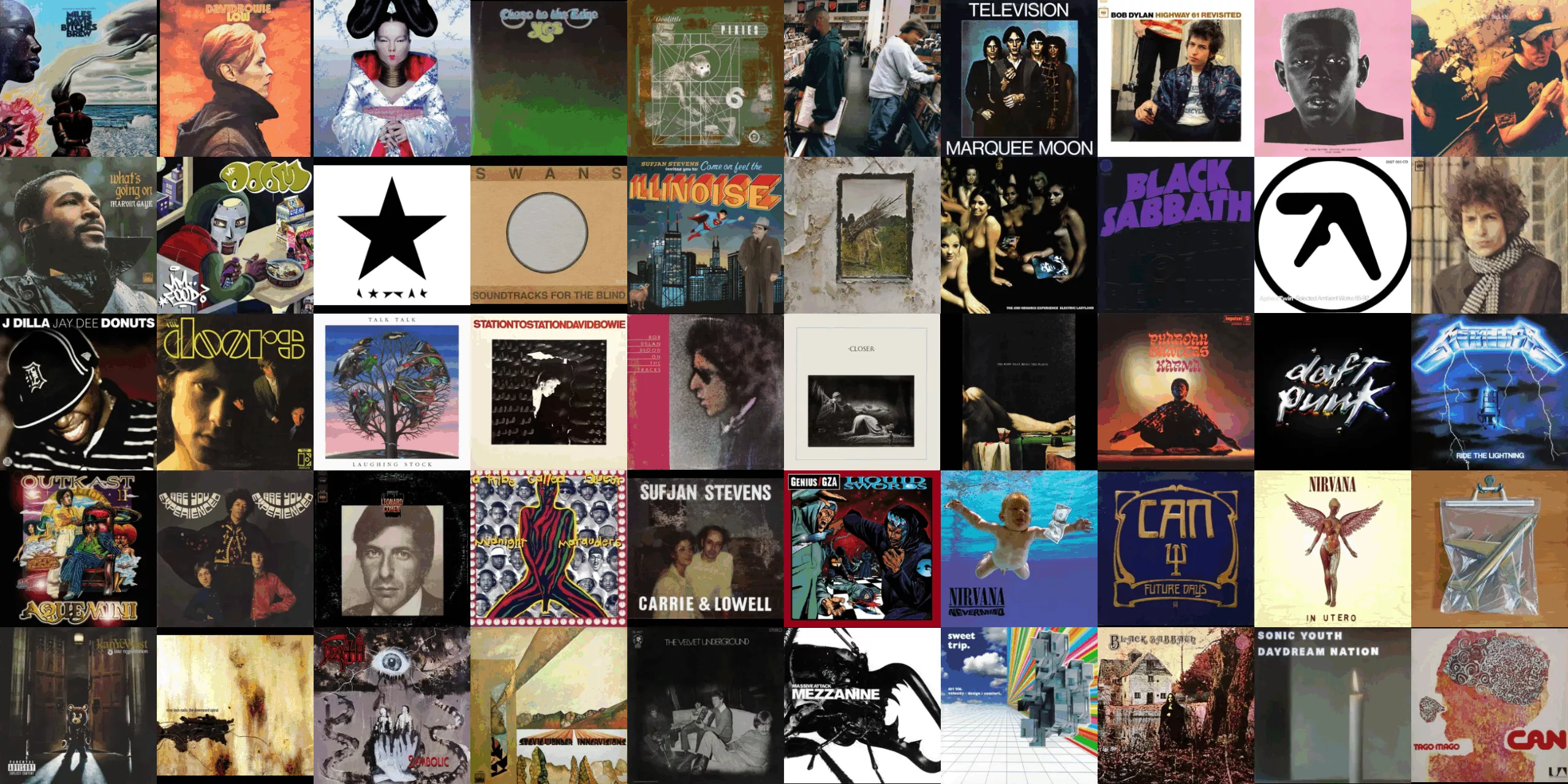1. Marvin Gaye – What’s Going On (Tamla/Motown, 1971)
Ce disque est la preuve que la beauté peut venir de la douleur. Marvin Gaye sortait d’un gouffre : la mort de Tammi Terrell, sa partenaire de duo, l’enfer de la célébrité, la guerre du Vietnam qui ravageait les esprits américains. Et soudain, il décide de chanter autrement. Plus de tubes de danse, plus de sourire Motown : juste un homme noir qui regarde le monde et pleure.
Enregistré aux mythiques Hitsville Studios de Detroit avec l’arrangeur David Van De Pitte et la légendaire section rythmique des Funk Brothers, What’s Going On révolutionne la soul. La basse liquide de James Jamerson serpente comme une conscience en éveil, les cuivres planent, les chœurs dialoguent avec la voix de Marvin, douce et enragée à la fois.
Les morceaux s’enchaînent sans rupture, formant une seule pièce : “Mercy Mercy Me (The Ecology)” pleure la planète, “What’s Happening Brother” raconte le retour d’un vétéran, “Inner City Blues” clôt l’album sur un cri de désespoir mystique.
Motown ne voulait pas le sortir. Trop politique. Trop lent. Trop risqué. Marvin Gaye a insisté. Résultat : le plus grand album de soul de tous les temps, une prière électrique, un miroir tendu à l’Amérique. Et la réponse, cinquante ans plus tard, est toujours la même : non, Marvin, rien n’a vraiment changé.
2. The Beach Boys – Pet Sounds (Capitol, 1966)
Brian Wilson n’avait plus besoin de surfer : il voulait flotter dans sa tête. Pendant que le reste du groupe tournait, il restait enfermé dans les studios de Los Angeles avec les Wrecking Crew, une armée de musiciens de session capables de jouer les partitions les plus folles d’un génie en plein délire mélodique.
En 1966, Pet Sounds n’était pas seulement un album, c’était une réinvention totale du son. Des instruments improbables — thérémine, cloches de vélo, clavecin, bassons, boîtes à musique — se mêlaient à des harmonies vocales célestes et à des arrangements orchestraux d’une précision quasi mathématique. Brian Wilson, nourri par le LSD et la foi pop, voulait créer “un disque sans faille, où chaque chanson te brise un peu plus”. Résultat : un album d’une mélancolie pure, entre rêve adolescent et désillusion adulte. “God Only Knows” est peut-être la plus belle chanson d’amour jamais écrite, “Wouldn’t It Be Nice” un cri naïf vers l’âge adulte, “Caroline, No” une conclusion déchirante.
Les Beatles, bluffés, répondront avec Sgt. Pepper.
Mais Pet Sounds, lui, reste suspendu dans l’air comme une prière en technicolor. Un disque pour ceux qui entendent la tristesse dans le beau.
3. Joni Mitchell – Blue (Reprise, 1971)
Il y a des albums qui t’écoutent pendant que tu les écoutes. Blue est de ceux-là. Joni Mitchell, 27 ans, s’enfuit en Grèce après une rupture avec Graham Nash. Seule, elle écrit sur ses voyages, ses amants, ses regrets, sa fille cachée. De retour à Los Angeles, elle enregistre Blue en quelques semaines, armée d’une guitare accordée comme un secret et d’un piano tremblant. Chaque chanson est un aveu en clair-obscur : “River”, “A Case of You”, “Carey”. Sa voix, aiguë et fragile, traverse le vinyle comme une lame. La production de Henry Lewy est d’une sobriété bouleversante : pas d’artifice, juste l’intimité brute d’une femme qui ose tout dire.
Techniquement, Blue a ouvert la voie à toute une génération d’auteures-compositrices : Tori Amos, Fiona Apple, Lana Del Rey… toutes doivent quelque chose à cette vérité nue. C’est l’un des meilleurs albums de tous les temps parce qu’il parle d’un cœur humain avec plus d’honnêteté que n’importe quel traité de psychologie. Tu ne l’écoutes pas, tu t’y reconnais.
4. Stevie Wonder – Songs in the Key of Life (Tamla/Motown, 1976)
Stevie Wonder avait 26 ans et déjà 10 albums derrière lui quand il a décidé de faire son chef-d’œuvre. Pendant deux ans, il enferme une armée de musiciens dans les studios Crystal Sound et Record Plant de L.A. Il expérimente, improvise, superpose des centaines de pistes avec ses claviers ARP, son synthétiseur TONTO et sa voix de prophète pop. Le résultat ? Un double album de 21 chansons, une somme sur la condition humaine. “Sir Duke” célèbre la musique, “I Wish” se souvient de l’enfance, “As” parle d’amour éternel, “Village Ghetto Land” dénonce la misère. Stevie joue presque tous les instruments, guidé par une oreille absolue et un cœur surdimensionné.
Sorti chez Motown après des mois de retards, l’album entre directement numéro 1. C’est un cosmos entier : funk, jazz, gospel, ballades et philosophie. Chaque écoute te rappelle que Stevie Wonder n’a jamais vu le monde — il l’a entendu mieux que nous tous.
5. The Beatles – Abbey Road (Apple, 1969)
Le chant du cygne. Fatigués, en guerre d’ego, les Beatles se retrouvent une dernière fois dans le studio qui porte leur nom. George Martin, le producteur magicien, recolle les morceaux et accouche d’une perfection presque irréelle. “Come Together”, “Something”, “Here Comes the Sun”, “Because”… chaque titre est une pierre précieuse.
L’enchaînement de la face B — “You Never Give Me Your Money” jusqu’à “The End” — est un mini-opéra pop d’une beauté hallucinante. Paul McCartney dirige tout, Lennon rêve ailleurs, Harrison explose enfin, Ringo frappe juste.
L’album est enregistré sur un huit pistes dernier cri, mixé avec une précision chirurgicale. C’est la fin et la renaissance à la fois. Quand ils traversent la rue pour la pochette, ils ne le savent pas encore, mais ils marchent vers l’éternité.
6. Nirvana – Nevermind (Geffen, 1991)
Trois types de Seattle ont changé le monde avec une guitare désaccordée. Kurt Cobain, Dave Grohl et Krist Novoselic débarquent chez Butch Vig, producteur punk, avec un carnet plein de rage et de douleur. Ils enregistrent Nevermind à Los Angeles, sans se douter que “Smells Like Teen Spirit” deviendrait le cri d’une génération perdue.
Le son, mélange de heavy metal, de punk et de pop mélodique, repose sur un équilibre parfait : couplets calmes, refrains explosifs. Cobain écrit comme on s’autodétruit : “Come As You Are”, “Lithium”, “Drain You” — des chansons sur le vide, mais pleines de vie. Techniquement, Butch Vig polit le chaos : guitares doublées, batterie compressée, voix mixée avec du reverb froid. Un disque imparfait, brut, mais inattaquable. Le grunge est né, et avec lui, le dernier vrai mouvement révolutionnaire du rock.
7. Fleetwood Mac – Rumours (Warner Bros., 1977)
C’est un miracle né du désastre. Pendant l’enregistrement, deux couples du groupe se séparent, tout le monde se déteste, la cocaïne coule comme un fleuve. Mais chaque tension devient mélodie, chaque trahison devient hit.
“Go Your Own Way” est un doigt d’honneur, “Dreams” une confession, “The Chain” une vengeance. Les harmonies vocales de Lindsey Buckingham, Stevie Nicks et Christine McVie sont ciselées comme du cristal sous acide. Ken Caillat et Richard Dashut, les producteurs, inventent un son californien à la fois luxueux et fragile : guitares brillantes, basse profonde, voix suspendues. Rumours vend plus de 40 millions d’exemplaires. C’est le paradoxe parfait : un disque de rupture qui rassemble. La preuve que le chaos, parfois, chante mieux que l’amour.
8. Prince – Purple Rain (Warner Bros., 1984)
Prince voulait tout : la pop, le funk, le rock, la sensualité et le salut. Avec Purple Rain, il les a tous avalés dans un seul éclair violet. Enregistré à Minneapolis, partiellement en live au First Avenue Club, l’album est un trip total : guitare orgasmique, synthés célestes, voix d’ange pervers.
“When Doves Cry” n’a pas de basse, et pourtant ça groove comme le diable. Le morceau-titre, enregistré live, reste une cathédrale émotionnelle : neuf minutes de transcendance. Prince joue presque tout, dirige tout, contrôle tout.
Purple Rain est la preuve qu’un seul homme peut contenir mille genres. Un chef-d’œuvre de démesure, une messe sexuelle, un manifeste pour les freaks de la planète.
9. Bob Dylan – Blood on the Tracks (Columbia, 1975)
Le cœur de Dylan saigne sur des bandes analogiques. Après l’échec sentimental avec Sara Lowndes, il écrit un album de rupture, d’une lucidité glaciale. Enregistré à New York puis remixé à Minneapolis, le disque alterne folk dépouillé et colère électrique. “Tangled Up in Blue” est un labyrinthe de mémoire, “Idiot Wind” un crachat sublime, “Shelter from the Storm” un adieu tendre. La production est brute, organique, volontairement inachevée. Chaque prise semble vivante, prête à s’écrouler.
Blood on the Tracks est le manuel du chagrin amoureux. C’est aussi la preuve que Dylan, même brisé, reste un poète armé.
Le rock, ici, devient littérature.
10. Lauryn Hill – The Miseducation of Lauryn Hill (Ruffhouse/Columbia, 1998)
Un seul album, et l’histoire est pliée. Lauryn Hill quitte les Fugees pour enregistrer son manifeste solo dans un studio du New Jersey. Elle écrit, produit, arrange, chante, rappe, prie.
Elle accouche en même temps d’un fils et d’un chef-d’œuvre.
“Miseducation” mêle gospel, reggae, soul, R&B et hip-hop avec une aisance céleste. “Doo Wop (That Thing)” est une claque féministe, “Ex-Factor” une confession amoureuse, “To Zion” une berceuse divine. Les arrangements live, les cuivres chauds, les chœurs d’église donnent à l’album une texture organique rare pour la fin des années 90.
Hill y prêche la rédemption, la foi, la maternité et la liberté artistique. Elle ne refera jamais rien d’aussi fort — mais elle n’en avait pas besoin. C’est l’un des meilleurs albums de tous les temps, et aussi l’un des plus humains.