Aerosmith : biographie, discographie, style et héritage
Ils surgissent dans la brume poisseuse du rock américain comme les ombres d’un glorieux millénaire en fin de parcours, trimballant leur blues empoussiéré des faubourgs industriels de Boston jusqu’aux pittoresques excès des palaces hollywoodiens. Aerosmith, c’est un nom qui se susurre à la fin des nuits blanches, celui d’un groupe emblématique qui a transfiguré la musique rock à coups de riffs ghéologiques, de refrains scotchés aux tympans, et d’une attitude flirtant sans cesse avec la frontière du too much.
L’histoire du rock n’aurait sans doute pas la même saveur, ni le même groove, sans leur insistance à vouloir tout brûler – scènes, charts, nerfs. Leur évolution musicale, pourvue d’autant de zigzags qu’un vinyle usé, a puissamment marqué la culture musicale et la pop culture contemporaine. À quiconque pose ses oreilles sur Dream On ou Sweet Emotion, difficile de ne pas reconnaître cette empreinte grésillante, cette trace insidieuse de la démesure qui, depuis 1970, a transformé ces bad boys de Boston en figures héraldiques de la décadence rock.
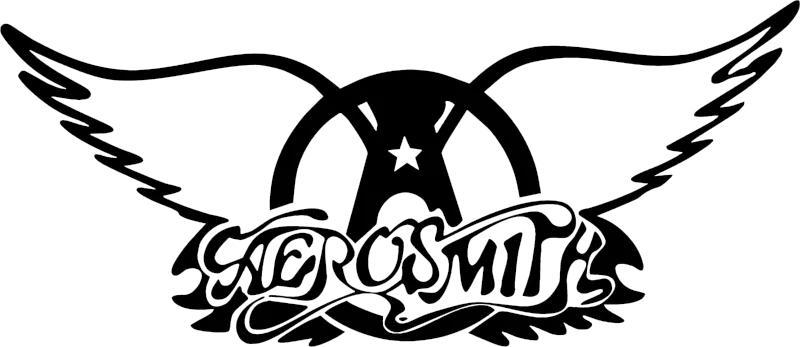
Leur longévité – un demi-siècle, excusez du peu – n’est pas seulement le fruit d’une obstination, mais aussi celui d’une capacité rare à sentir le parfum fugace du changement sans jamais céder à la capitulation esthétique. Entre balades surannées, hard rock inoxydable et flirt avec la pop, Aerosmith navigue avec une grâce de pachyderme dans la porcelaine médiatique, jonglant entre la grandeur et l’effondrement, la réinvention et la nostalgie fatiguée. L’ivresse d’un riff, la provocation d’un refrain, et le mythe persiste : jusqu’à leur dernière tournée annoncée en 2024, interrompue finalement par la voix brisée d’un frontman devenu légende vivante.
Fiche d’identité rapide
- Origine : Boston, Massachusetts, États-Unis
- Années d’activité : 1970 – 2024
- Genre(s) : Hard rock, blues rock, rock, pop-rock, metal, rhythm and blues
- Membres fondateurs : Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer, Ray Tabano (remplacé par Brad Whitford en 1971)
- Chansons les plus connues : Dream On, Sweet Emotion, Walk This Way, Dude (Looks Like a Lady), I Don’t Want to Miss a Thing
- Labels : Columbia Records, Geffen Records, Universal Music Group
Origines et formation : dans les entrailles du rock bostonien
Boston, 1966. Les effluves de la révolution à venir dans le rock triturent déjà la nappe phréatique des groupes adolescents. Un gamin nommé Steven Tallarico – qui deviendra plus tard Steven Tyler – bat le rythme sur des peaux de batterie, avant que la voix, ce scalpel rauque, ne prenne le relais. Dans une Amérique qui s’étourdit de psychédélisme, la rencontre avec Joe Perry, jeune guitariste dont les influences balancent entre le blues des origines et la fureur de Cream, laisse présager une collision de planètes.
Il y a des histoires de clubs obscurs – the Barn au New Hampshire, où le Jam Band de Perry et Hamilton côtoie la Chain Reaction de Tyler. On s’échange plus d’accords que de politesses, puis la fusion s’opère sur l’autel d’une musique pleine de sueur et de micro brisé. Tyler prend le micro, Joey Kramer plante sa batterie comme une tente de fortune au cœur du chaos, et Brad Whitford vient remplacer Ray Tabano à la guitare rythmique.

Aerosmith biographie, discographie, style et héritage
L’alchimie ne tarde pas, propulsée par cette sainte trinité du malaise et de la rage électrique. Les campus de la côte Est deviennent leur terrain de jeu, les bars universitaires leur chapelle profane. D’un bouche-à-oreille fiévreux naît un cercle de fans prêts à suivre la meute jusqu’au bout de leurs cordes vocales.
Le manager célèbre Clive Davis, flairant le sang neuf lors d’un passage au Max’s Kansas City, signe un groupe qui n’a pas encore de réputation radio, mais déjà l’arrogance de ceux qui viennent démolir le statu quo. Surgit alors, en 1973, leur premier album éponyme, condensé de tension fauve et de mélodies inavouablement catchy, notamment via une ballade Dream On qui, dans ses premiers frissons, n’imagine pas qu’elle tournera un jour en boucle sur des stades entiers.
Chronologie et carrière : ascensions stroboscopiques, chutes sur le fil
La narration d’Aerosmith frôle souvent la tragicomédie shakespearienne : ascensions météoriques, descentes tabagiques, retours pas franchement nets – mais tels sont les cycles du rock. Leur galopade discographique commence par l’essuyage de plâtres, l’album Aerosmith se vendant prudemment (euphémisme poli pour « pas terrible hors de Boston »), mais ce n’est qu’une amorce retorse. Get Your Wings (1974) scelle le contrat avec le public US, mention spéciale à Same Old Song and Dance ou l’indestructible Train Kept A-Rollin’.
Il faudra l’explosion pernicieuse de Toys in the Attic (1975) pour que la célébrité déverse tout son fiel et sa lumière. Walk This Way, Sweet Emotion : deux hymnes qui crèvent le plafond des charts et des limbes collectives. Le groupe se paie le luxe d’une croissance sous amphét’, jusqu’au point de rupture. Rocks (1976), salué comme une confirmation plus qu’une révolution, tente de garder la boussole, mais entre 1977 et 1979, la poudre devient l’apéritif national. Draw the Line tangue, Night in the Ruts vacille, et Joe Perry jette l’éponge en pleine tempête – fondera plus tard The Joe Perry Project.
Les années 1980 apportent leur lot de compilations (Grands Hits, 1980) et d’albums inégalement digérés (Rock in a Hard Place, 1982), pendant que les membres du groupe se découvrent des talents pour tout, sauf la stabilité. La cure de désintoxication, ce passage obligé du rock U.S., devient alors le décor ténu d’un retour en grâce. Done with Mirrors (1985) n’est pas un triomphe, mais la reformation de la formation originale ranime le flambeau.
Et puis il y a 1986 : Walk This Way renaît, greffée aux beats furieux de Run DMC, accouchant d’une fusion iconoclaste rock-rap – un hybrid moment majeur de la culture musicale désignée pour les books d’histoire et les classements RockSound. La fin des eighties et la décennie suivante déroulent un tapis d’or et d’argent : Permanent Vacation, Pump, Get a Grip. Les tubes dévalent les ondes – Dude (Looks Like a Lady), Janie’s Got a Gun, Cryin’, What it Takes.
Les nineties sont une orgie de concerts, de scandales et de clips sur-rotoscopés (merci MTV). Viennent encore plus tard Nine Lives, Just Push Play, Honkin’ on Bobo : albums d’un registre inégal, mais qui maintiennent la mythologie en orbite. Les années 2000 signent autant de tournées XXL, de projets annexes et d’hommages officiels qu’un rockeur peut en avaler avant la retraite.
Retour final dans le ring avec Peace Out: The Farewell Tour en 2023. Tournée rongée par la poisse, incidents de santé – la voix de Steven Tyler en sort meurtrie. L’ultime date, celle d’Elmont en septembre 2023, referme le rideau, laissant le rock orphelin d’un totem de plus.
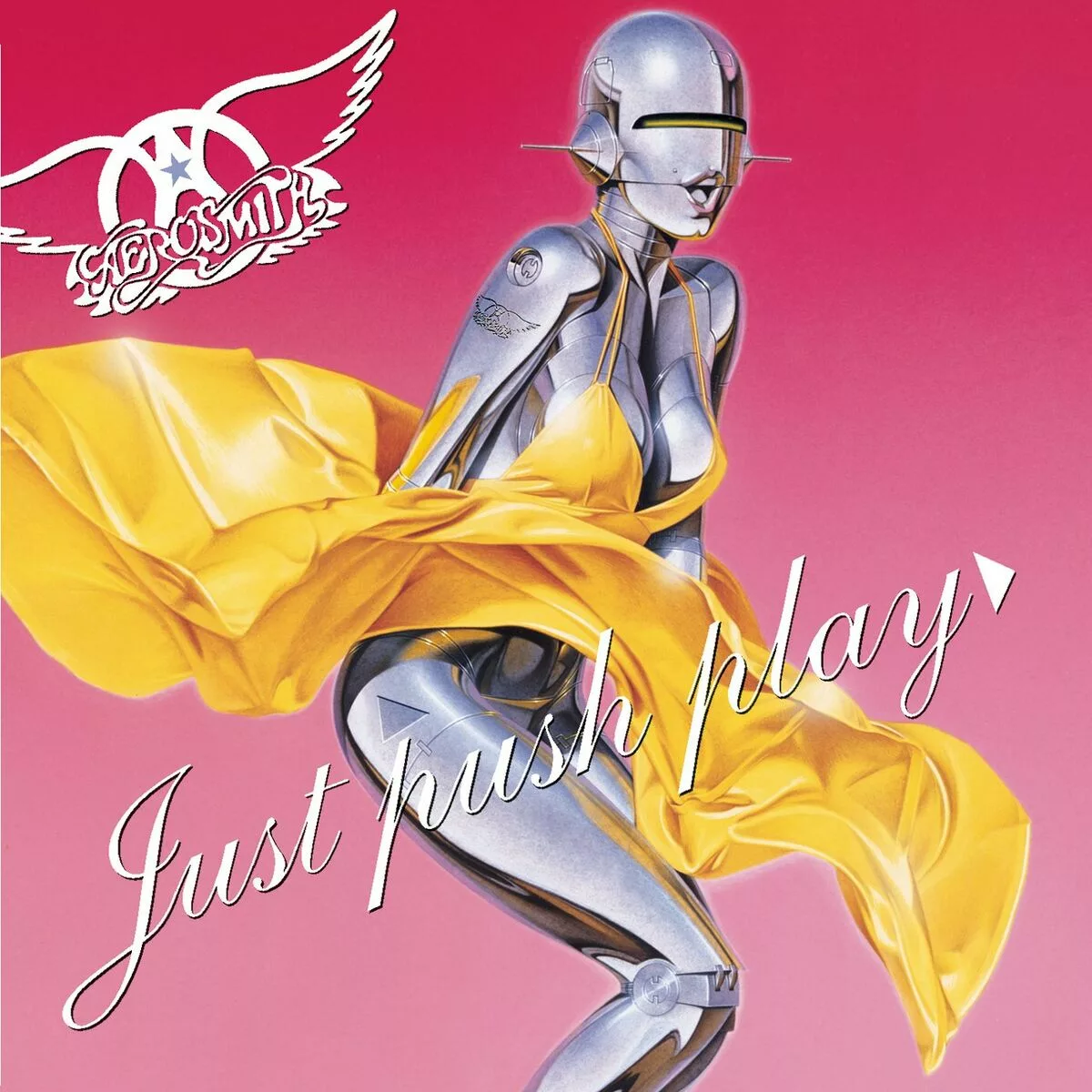
Aerosmith biographie, discographie, style et héritage
Style musical et influences : géologie du riff et mutations soniques
Cataloguer Aerosmith, c’est comme résumer la faune d’un marécage halluciné : ça glisse, ça mue, ça surprend toujours. Les racines s’enfoncent dans la glaise bluesy, mais la sève coule hard rock, couverte de sédiments pop, metal, glam et même hip-hop dès les collisions avec Run DMC. Entre Stones et Led Zeppelin, Aerosmith cultive au début des seventies cette sale manie d’électriser tout ce qu’ils touchent.
L’influence du blues anglais n’est pas un hasard : Joe Perry a autant de Jimmy Page que de Keith Richards dans les doigts, tandis que Tyler raille, gémit, psalmodie – moitié Jagger, moitié prédicateur du samedi soir. Leurs premiers disques citent Cream, Fleetwood Mac (voir cette reprise mythique du “Rattlesnake Shake”), mais très vite le son s’impose, indéboulonnable, plein de vibrato et d’harmoniques.
La mutation commence quand la pop U.S. envahit les radios : le groupe autorise alors claviers, cuivres, arrangements sucrés mais distille toujours ses solos à la Splash Gordon – voir Get a Grip et ces ballades calibrées pour MTV, mais bardées d’allusions à l’histoire du rock. Permanent Vacation ou Pump flirtent avec la FM, mais gardent le venin. Sur scène, la musique d’Aerosmith demeure un orage de décibels, une messe noire à ciel ouvert, où chaque chanson se mue en manifeste.
L’influence d’Aerosmith est bien plus tentaculaire qu’il n’y paraît : Guns N’ Roses, Metallica, même Foo Fighters leur doivent quelques dettes, notamment dans l’art de foncer la tête la première tête dans le mur du son. Les bandes-son de cultura américaine, des stades de baseball aux baisers adolescents, ne résistèrent pas à la déferlante Aerosmith. Pour s’en convaincre, voir ici comment des générations de rockers – de la Gibson Les Paul standard à la Squier laquée – perpétuent le geste acide du riff signature Perry-Whitford (en savoir plus sur l’influence guitare).
La musique du groupe, c’est aussi une culture lézardée de références, de samples et de clins d’œil. Ils inspirent, provocent, déçoivent parfois, mais rien dans la sphère rock ne reste indifférent à leur passage.
Anecdotes et moments marquants : entre poudre, clashs et mythes vivants
Impossible de parler de Aerosmith sans évoquer la chronique délirante de leurs errances – on pense aux Toxic Twins, surnom clin d’œil involontaire à la guerre chimique menée dans leurs narines par Steven Tyler et Joe Perry. Stardom oblige, la dope coule à flots et le chaos des eighties laisse des traces : bastons, départs soudains, comebacks thérapeutiques. À la croisée des clashs et des réconciliations, les concerts tournent souvent à l’orgie contrôlée, les interviews à la punchline furieuse.
Un jalon incontournable reste la collaboration contre-nature avec Run DMC en 1986. Le producteur Jam Master Jay pose la chape de beats sous l’ancestrale Walk This Way, inaugurant une ère hybride où le rock blanc courtise le hip-hop naissant. Résultat : la planète bouge, MTV explose, les dancefloors aussi.
Citons aussi ces concerts fous, tel le passage explosif à l’UBS Arena d’Elmont en septembre 2023, où la blessure irréversible du larynx de Steven Tyler tranche net l’histoire. Ou ce Texas Jam de 1978 devant 150 000 personnes, orgie d’énergie, de décibels et de sueur – émulation sur carte postale, à s’envoyer sans filtre depuis la fosse.
Sur le plan des collaborations, Aerosmith ne fait pas les choses à moitié. Chœurs partagés avec Alice Cooper sur Trash (1989), apparition dans les Simpsons (la pop culture, encore et toujours), sans compter les featurings récents ou apparitions lors de tournées avec Kiss. Chaque musicien croisé sur leur route, du producteur Jack Douglas aux acolytes de la discographie américaine classique, laisse une empreinte sur leur évolution musicale.
La dernière anecdote tient dans cette annulation contrariée de tournée en août 2024 – le groupe ayant sans doute tutoyé trop fort les plafonds de verre du rock américain, s’effondre non pas sur un scandale mais sur la simple loi biologique : la voix, outil principal, se brise, et les idoles désertent la scène, non sans laisser un dernier murmure électrique trainant dans les coulisses.
Récompenses et reconnaissance : capitalisation sur l’éternité
Le groupe emblématique Aerosmith coche toutes les cases de la mythologie rock, y compris celles du panthéon officiel. Quatre Grammy Awards dans la besace, dont le prix de la “Meilleure chanson rock” pour Janie’s Got a Gun, Livin’ on the Edge, ou encore Pink. Un nombre à deux chiffres de MTV Video Music Awards, faisant du groupe le leader dans la catégorie “meilleure vidéo rock”.
Côté reconnaissance des pairs, l’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame intervient en 2001, comme une validation institutionnelle d’une carrière émaillée de records et de controverses. Les American Music Awards (six fois honorés), Billboard Music Awards, Boston Music Awards, People’s Choice Awards parsèment également leur parcours, offrant à leurs manteaux de cuir des décorations que Keith Richards pourrait jalouser – sans l’avouer.
L’éloge ne vient pas que des prix, mais aussi du plébiscite : plus de 150 millions d’albums écoulés à l’international, 70 millions sur le seul marché américain selon le label. Et puis, le Massachusetts leur consacre un “Aerosmith Day”, ce qui en dit long sur la capacité d’un groupe à transformer l’hystérie rock en fête d’État.
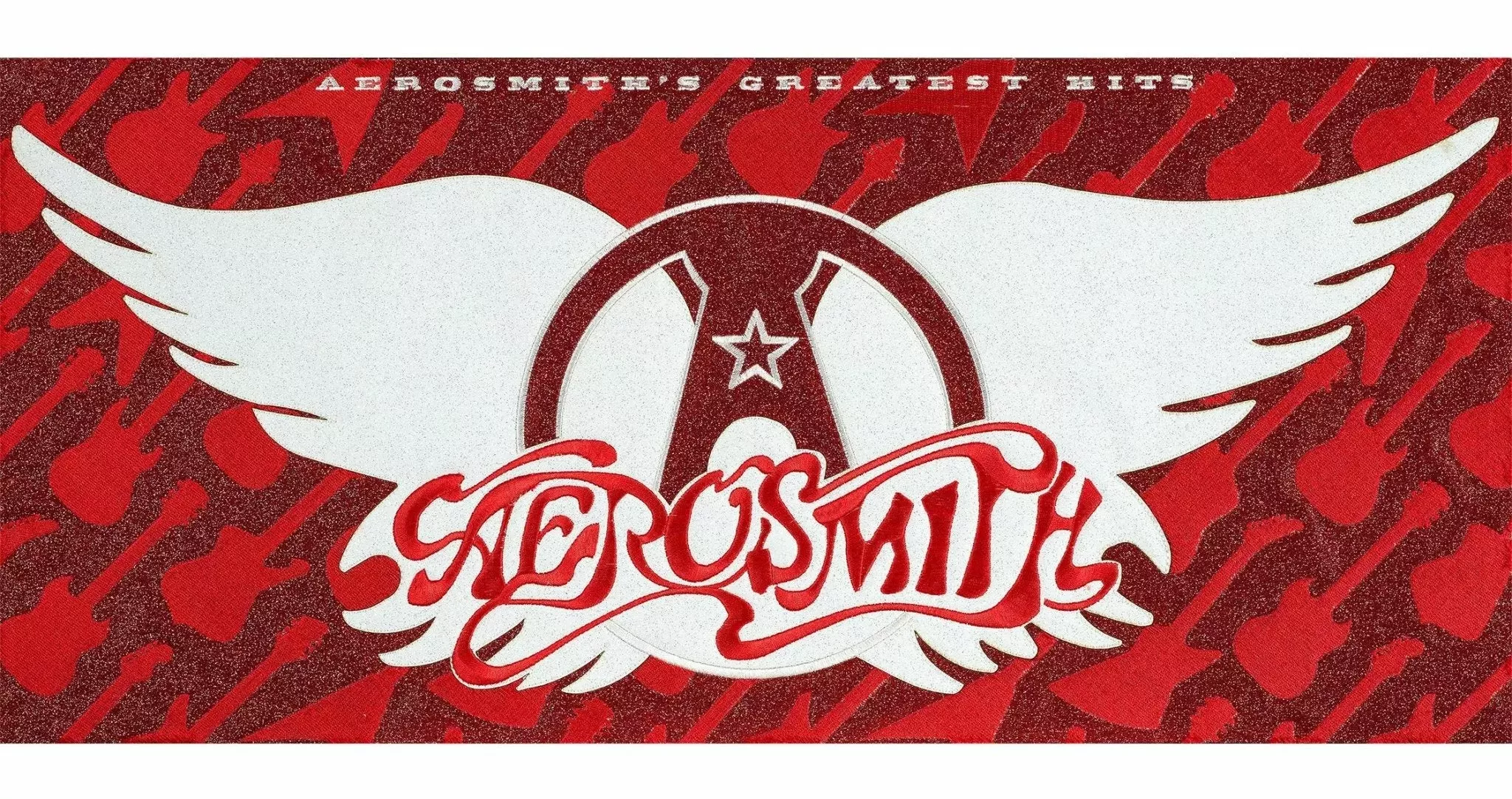
Les entrées dans le classement des 100 plus grands artistes de tous les temps par Rolling Stone – 57e place, ce n’est certes pas l’Olympe, mais pour un groupe biberonné à la marge et à la démesure, c’est déjà plus qu’un montant maximal d’ego à tenir jusqu’à la comète finale. Un trophée pour la rubrique “influence” qui, comme l’histoire du rock, s’écrit au fil de riffs et de signaux de fumée électrique.
Et surprise, certains trophées viennent d’horizons plus inattendus, comme ce Soul Train Music Award pour la meilleure collaboration rap, clin d’œil à leur infiltration féconde dans la culture musicale hip-hop au fil des décennies. La légende se pérennise, entre musées, hommages et remise de prix, verrouillant leur place au sein du panthéon musical moderne.
Albums clés et discographie complète : l’archive gravée dans la cire
Des bootlegs de 1971 aux sommets commerciaux des nineties, la discographie d’Aerosmith n’est pas qu’une liste – c’est un trip labyrinthique. Beaucoup retiendront Toys in the Attic pour sa doublette Walk This Way/Sweet Emotion ; Get a Grip pour le triomphe commercial ; Rocks pour l’influence sur la nouvelle génération. Mais la vérité gît dans les interstices, des lives crasseux aux compilations dorées.
| Album | Année | Label | Certification | Fait notable |
|---|---|---|---|---|
| Aerosmith | 1973 | Columbia | 2× Platine (US) | Contient la première version de Dream On, succès d’estime à sa sortie |
| Get Your Wings | 1974 | Columbia | 3× Platine (US) | Premier album produit par Jack Douglas, début de la « marque sonore » Aerosmith |
| Toys in the Attic | 1975 | Columbia | 8× Platine (US) | Walk This Way et Sweet Emotion, porte d’entrée vers la célébrité mondiale |
| Rocks | 1976 | Columbia | 4× Platine (US) | Citée comme influence majeure par Slash (Guns N’ Roses) et James Hetfield (Metallica) |
| Draw the Line | 1977 | Columbia | 2× Platine (US) | Sorti dans une période d’excès, titres Kings and Queens et Draw the Line |
| Night in the Ruts | 1979 | Columbia | Or (US) | Marké par le départ de Joe Perry, influence blues persistante |
| Rock in a Hard Place | 1982 | Columbia | Or (US) | Seul album sans Perry et Whitford, période trouble |
| Done with Mirrors | 1985 | Geffen | Or (US) | Retour du line-up original, production sobre |
| Permanant Vacation | 1987 | Geffen | 5× Platine (US) | Dude (Looks Like a Lady), résurrection auprès du grand public |
| Pump | 1989 | Geffen | 7× Platine (US) | Janie’s Got a Gun, Love in an Elevator, retour en grâce critique |
| Get a Grip | 1993 | Geffen | 7× Platine (US) | Cryin’, Amazing, Crazy : ballades populaires, plus hautes ventes mondiales |
| Nine Lives | 1997 | Columbia | 2× Platine (US) | Sortie tumultueuse, singles Falling in Love, Pink |
| Just Push Play | 2001 | Columbia | Platine (US) | Jaded, modernisation pop-rock du son Aerosmith |
| Honkin’ on Bobo | 2004 | Columbia | Or (US) | Retour aux sources blues, reprises saluées |
| Music from Another Dimension! | 2012 | Columbia | — | Dernier album studio, grand écart générationnel |
On aurait tort d’oublier les live (Live! Bootleg, 1978), les compilations (Greatest Hits, Big Ones, Pandora’s Box), et surtout les titres passés à la postérité : I Don’t Want to Miss a Thing (bande-son du film Armageddon, Césarisée à sa manière), Dream On pour les apôtres du slow fataliste.
Les critiques oscillent d’un album à l’autre : Rocks salué pour son influence féroce sur le metal et le hard rock, Get a Grip pour sa popularité commerciale. Mais l’ensemble reste marqué par une faculté troublante à polariser – cuvée adorée ou défoncée, rarement tiède.
À chaque disque, un prolongement de ce bras de fer entre la tradition électrique et la volonté de survivre à la next big thing. Dans la grande histoire du rock, Aerosmith imprime au vinyle une cicatrice indélébile, comme une ponctuation hargneuse à chaque chapitre.
Dans la culture populaire : le rock en héritage, caméos et légendes digitales
Aerosmith ne s’est jamais contenté des planches ou des studios : leur empreinte explose dans tous les recoins de la culture musicale depuis cinquante ans. Romans graphiques, pubs décadentes, caméos dans Les Simpsons (qui n’a pas ri devant Moe leur préparant un cocktail piteux ?), participations à la BO de blockbusters (la fameuse I Don’t Want to Miss a Thing pour Armageddon, portée par Liv Tyler fille du frontman).
Dans le cercle des jeux vidéo, leur influence trouve un autre écho : Guitar Hero: Aerosmith (2008) les propulse comme le premier groupe à avoir son propre épisode de la série. Les ados, entre deux solos virtuels, découvrent Train Kept A-Rollin’ en écrasant du plastique. Dans Revolution X ou Quest for Fame, la frontière entre manette et guitare se dissout – une performance à bornes multiples, pour joueurs de tous âges.
N’oublions pas leur entrée fracassante dans l’attraction Rock ’n’ Roller Coaster du parc Walt Disney Studios, qui embarque les visiteurs dans un voyage catapulté sous bande-son hard rock. Les parodies télévisuelles et détournements abondent, de SNL à South Park, preuve que la marque Aerosmith s’insinue partout, y compris là où on ne l’attendait pas.
Le détournement de Walk This Way par des DJs du monde entier, la reprise incessante de Sweet Emotion par des cover bands ou dans la pub mainstream, incarnent ce moment rare où une chanson transcende son époque. L’impact dans l’histoire du rock se mesure aussi à cette capacité à infuser la vie quotidienne. Qu’on veuille ou non, difficile d’oublier un air qui, génération après génération, refuse de se taire.
FAQ – Ce que vous vous demandez sur Aerosmith
- Quel est le véritable impact d’Aerosmith sur l’évolution du rock américain ?
Par leur capacité à fusionner blues, hard rock et pop, Aerosmith a imposé un style accessible tout en conservant une attitude provocatrice, inspirant de nombreux groupes modernes et élargissant la portée du rock à travers des collaborations croisées comme avec Run DMC.
- La formation originale d’Aerosmith a-t-elle toujours été intacte ?
Non. Si la formation classique réunit Tyler, Perry, Whitford, Hamilton, Kramer, le groupe a connu des départs et retours (notamment Perry et Whitford entre 1979 et 1984), ce qui a marqué différentes textures musicales selon les époques.
- Comment la chanson Walk This Way est-elle devenue si légendaire ?
À l’origine tube hard rock des années 70, Walk This Way renaît en 1986 dans une version remixée avec Run DMC, incarnant un métissage inédit entre rock et hip-hop et touchant un public intergénérationnel désormais familier du cross-over.
- Combien d’albums Aerosmith a-t-il vendu dans le monde ?
Selon Universal et les estimations de l’industrie musicale, Aerosmith a écoulé plus de 150 millions d’albums à l’international, dont près de 70 millions aux États-Unis – ce qui le hisse parmi les groupes les plus vendeurs de l’histoire.
- Quel a été le point le plus bas dans la carrière du groupe ?
L’épisode le plus difficile demeure la fin des années 70-début 80, marquée par l’abus de drogues, des départs de membres clés, et des albums moins acclamés – période surmontée par un retour sobre et un regain de succès à la fin des années 80.
- Quels musiciens et groupes revendiquent l’influence d’Aerosmith ?
De nombreux géants du rock et du metal, tels que Guns N’ Roses, Metallica, Foo Fighters ou Bon Jovi, ont cité Aerosmith comme une référence majeure, tant pour leur virtuosité que pour leur énergie scénique hors-norme.
- Quelles récompenses notables ont été obtenues par Aerosmith ?
En plus de quatre Grammy Awards et dix MTV Video Music Awards, Aerosmith a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2001, consacré par la critique et reconnu par ses pairs pour sa contribution durable à la culture rock.
- Qu’est-ce qui a provoqué l’arrêt définitif du groupe en 2024 ?
Une blessure irréversible au larynx de Steven Tyler lors d’un concert en 2023, ajoutée à d’autres soucis de santé, a rendu la poursuite des tournées impossible, forçant le groupe à annoncer la fin de sa carrière en août 2024.
- Aerosmith a-t-il marqué d’autres domaines que la musique ?
Oui. Entre jeux vidéo, caméos dans des séries cultes (The Simpsons, South Park), attractions de parcs à thème et publicités grand public, leur influence déborde très largement le simple cadre musical et s’imprime dans la culture populaire élargie.
- Quelle est, selon la critique, la plus grande force d’Aerosmith ?
Outre une capacité à se réinventer, la plus grande force du groupe demeure la connexion quasi instinctive avec le public en concert, soutenue par la voix unique de Tyler et la synergie Perry-Whitford à la guitare, ingrédient essentiel de leur longévité.
Conclusion
Inoxydable, imparfait mais inépuisable, Aerosmith occupe en 2025 la place de l’ogre que la musique rock aura sculpté à coup d’excès, d’échecs fulgurants et de conquêtes viscérales. Des clubs poussiéreux de Boston à la déchéance glamour de LA, du blues crade aux ballades immaculées des radios FM, le groupe reste une référence aussi fiable que la Gibson Les Paul branchée dans un Marshall à lampes prêt à imploser. Leur discontinu exigé par les circonstances – biographies, discographie, concerts mythiques, traversées du désert et retour sur la scène mondiale – compose une fresque où chaque faille devient mythe et chaque hit s’impose comme une balise générationnelle.
Pour prolonger le riff, éplucher les anecdotes, et revivre la saga d’un des groupes phares de l’histoire du rock, rien de tel qu’un détour nostalgique par le site officiel.







