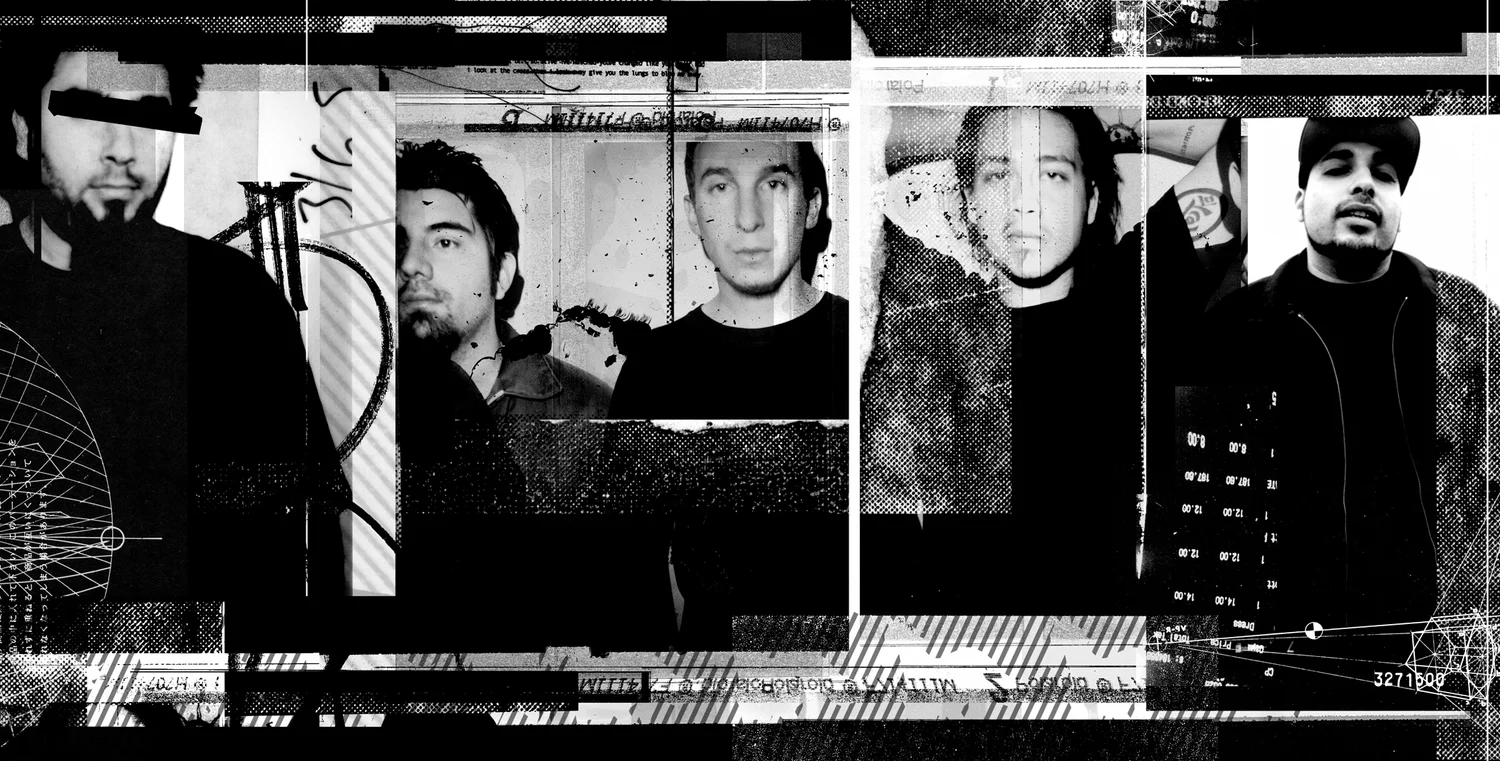Sous le décorum spectral des années 2000, alors que le nu metal érigeait ses cathédrales de riffs saturés pour une génération rongée par la désillusion, « White Pony » de Deftones se détache tel un animal mythique. Album pivot, tour de force d’un groupe refusant de suivre la meute, ce disque aussi insaisissable que son titre s’invitait dans les platines fatiguées du monde entier. Vingt-cinq ans plus tard, impossible d’ignorer la traînée de poudre qu’il a laissée, ravivant périodiquement la scène musicale alternative, brouillant à jamais les frontières entre rock expérimental, screamo, musique alternative et errances électroniques. Une dissection s’imposait, autopsie d’un impact qui n’a pas fini de se répercuter sur les tympans des générations successives.
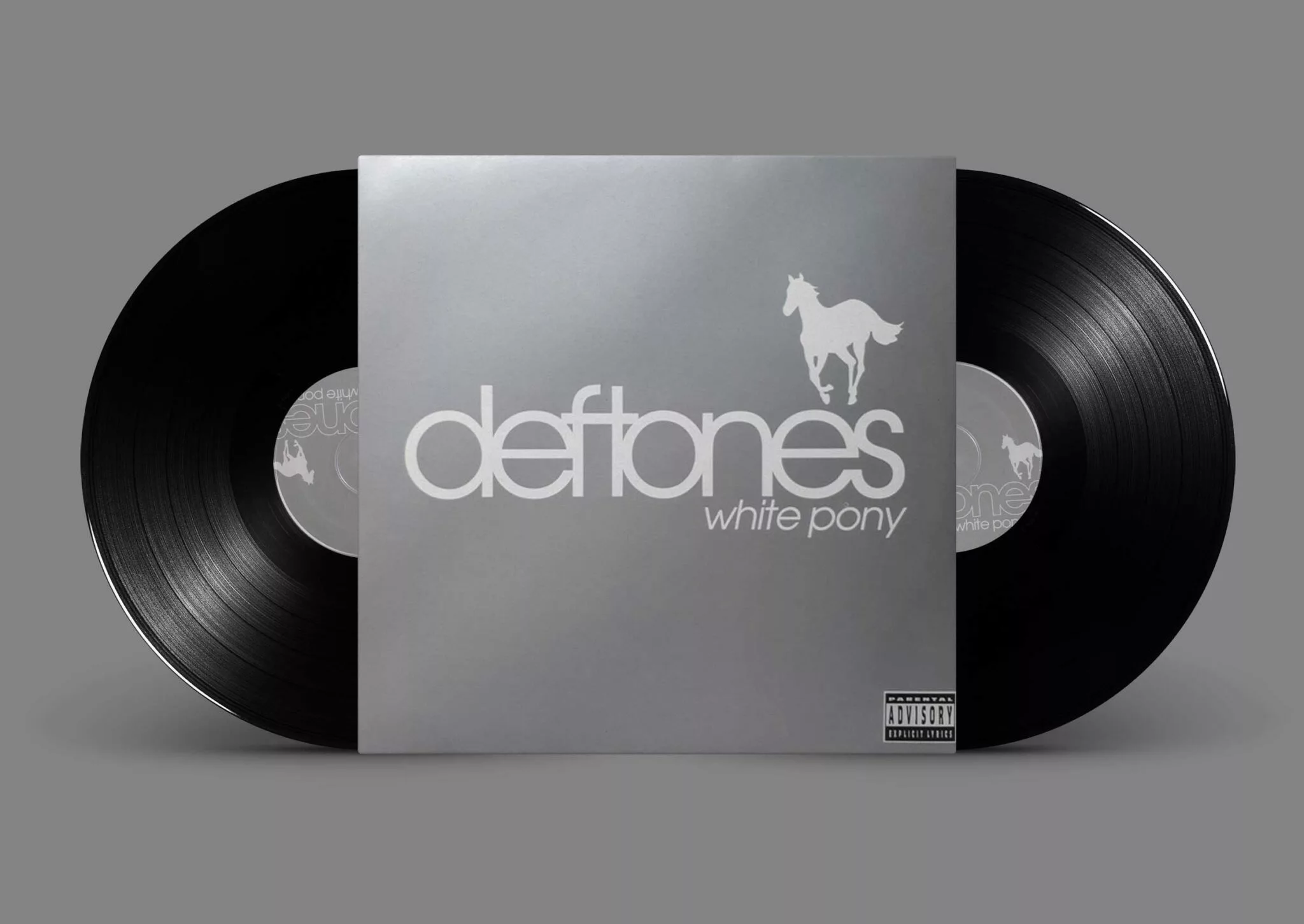
Fin des années 90, Sacramento ressemble davantage à une banlieue industrielle qu’à un vivier de génies créatifs. Pourtant, dans ce rectangle poussiéreux du nord de la Californie, Deftones dégainait déjà deux albums notables : « Adrenaline » et « Around the Fur ». L’Amérique post-grunge, gorgée de névroses adolescentines et de grands sweatshirts, avait déjà élu ses porte-drapeaux du nu metal, ces enfants perdus croisant le fer entre frustrations existentielles et riffs vindicatifs. Korn impose sa marque, Limp Bizkit fait danser les foules blasées, mais Deftones se démarque. Leur univers, à la fois lascif et furieux, témoigne d’une volonté de ne pas simplement chevaucher la vague, mais d’y imprimer leur signature.
La scène musicale est saturée. Les radios alignent sans ciller les refrains formatés, l’industrie cherche son nouveau Nirvana du troisième millénaire. Deftones refuse la facilité : Chino Moreno, charismatique et ténébreux, traîne ses démons et ses lectures de poésie beat dans un cercle aussi fermé que celui d’un club de vieille garde où la médiocrité ne fait pas long feu. Ses acolytes – Stephen Carpenter à la guitare (plus massif qu’une colonne d’amplis Orange), Abe Cunningham à la batterie (précis comme une montre suisse), Frank Delgado aux platines, et Chi Cheng à la basse, discret mais déterminant – voient poindre le défi d’un troisième album.
L’enjeu ? Ne pas répéter, mais transcender.
En France, pendant que des ados se jettent sur les compilations de musique alternative et de rock expérimental, Deftones creuse son sillon. À l’heure où le screamo commence à infecter les caves humides de l’hexagone et que le rap-metal tente son OPA hostile sur les enceintes du vieux continent, le quintet californien prépare en sourdine ce qui deviendra son album emblématique. Une musique hybride, mutante, farouchement inassignable dans les cases du marketing, se trame. White Pony, déjà, se profile. Les attentes sont là, mais personne ne pressent le séisme – pas même la bande, trop occupée à repousser les limites de son propre ego sonore.
L’air du temps porte à l’expérimentation. Tout, dans le paysage musical, pousse au mélange : Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins ou Radiohead défrichent le terrain sur d’autres continents du son. Mais l’histoire retiendra que Deftones, en 2000, allait livrer bien plus qu’un simple manifeste de nu metal. White Pony, c’est une école de l’ambiguïté faite album, une déclaration de guerre contre l’uniformisation du rock américain. Le détonateur était amorcé.
État d’esprit du groupe avant la tempête White Pony
Cette période pré-White Pony respire le changement d’époque. Les membres de Deftones, conscients de la nécessité d’évoluer, s’isolent, testent, doutent, remettent en cause leur propre esthétique. Chino commence à explorer des territoires lyriques où la violence devient suggestion, où la sensualité rôde sous les bruissements électriques. On raconte en backstage que Carpenter, jamais loin d’une crise de foi sur la nature du riff parfait, peine à renier les sirènes du metal pour aborder des rivages plus ambivalents.
Abe Cunningham, lui, perfectionne une frappe aux accents quasi-jazz, offrant à la batterie le rôle de colonne vertébrale rythmique, flexible et imprévisible. L’intégration de Frank Delgado, magicien du sample et manipulateur de vinyles, accentue le virage vers l’expérimental, rendant l’écriture collective aussi patiente qu’une session de méditation transcendantale. Ce terreau, fertile et mouvant, va bientôt donner naissance à une énigme musicale destinée à marquer la scène musicale alternative pour longtemps.

Session de studio et coulisses de White Pony : entre chaos créatif et miracles électroniques
Les limbes du studio – ce sanctuaire où chaque formation redoute de se perdre ou de se retrouver. Avec White Pony, Deftones pénètre dans le studio Larrabee Sound, à Los Angeles, armé de ses contradictions et d’une palette sonore encore inexplorée. Le riff, instrument fétiche d’une décennie, y croise soudain les ombres éthérées d’un clavier ou la brume digitale d’un sample obscur.
Au cœur de cette dynamique, le producteur Terry Date, déjà artisan de leurs deux premiers albums, orchestre le chaos ambiant. Détenteur d’oreilles capables de repérer la magie au creux d’un hurlement maladroit ou d’une boucle accidentelle, Date encourage les digressions, les disputes créatives, et les sursauts d’inspiration nocturne. Les nuits s’enchaînent, ivres de tests et d’expérimentations – impossible de savoir si la bande est sur le point d’accoucher d’un chef-d’œuvre ou de se dissoudre dans la brume des excès.
Les anecdotes circulent comme autant de polaroids fatigués : des prises de voix captées entre deux cigarettes, des pédales d’effets bricolées à la va-vite, des guitares branchées sur des amplis à moitié décomposés. Certains morceaux naissent de jams soudaines, d’autres s’imposent dans la douleur. Frank Delgado, nouveau venu, s’affirme en injectant un vernis électronique délicat, trouvant sa place entre le bruit blanc et la tempête métallique. Carpenter, souvent en désaccord avec Moreno sur la direction artistique, livre pourtant des parties qui deviennent quasi cultes – la solution naît fréquemment du conflit, la beauté dans la tension.
La genèse de « Digital Bath » ou « Passenger » s’apparente à une leçon de mixage déjantée. Maynard James Keenan de Tool, invité sur ce dernier morceau, impose son timbre sombre comme un totem inexpugnable. Dans un coin du studio traîne l’idée folle : confier un jour l’intégralité de White Pony à DJ Shadow, figure de proue du hip hop instrumental, pour un remix assumé. Ce fantasme, resté dans les tiroirs deux décennies durant, allait finir par accoucher de « Black Stallion », recueil de relectures électroniques taillé sur mesure pour éterniser l’aura du disque originel. Trois formats physiques, des collectors en veux-tu en voilà, et la boucle est bouclée pour les collectionneurs de bacs à vinyle surmenés.
Innovations et invités : la grande lessive du nu metal
Rarement un album de nu metal – ou musique alternative, ou rock expérimental, à ce stade, mettez-vous d’accord ! – n’a autant chassé sur des terres étrangères. Les balbutiements électroniques, l’intrusion de samples et la collaboration avec Maynard James Keenan ont permis à White Pony de s’extraire du magma sonore ambiant, traçant un trait d’union inattendu entre metal expérimental et pop cauchemardesque. L’ombre de DJ Shadow plane déjà, mais la vision reste inachevée – pour mieux éclore vingt ans plus tard.
Quelques voix racontent que les sessions s’étiraient jusqu’à l’épuisement, chacun tentant d’injecter une dose de chaos ou d’onirisme dans la matière brute du disque. Ces instants d’expérimentation sur le fil du rasoir deviendront l’ADN du White Pony, un album qui tient plus de l’hybridation que du manifeste, ouvrant la voie à une relecture constante, comme le montrera l’opus remixé Black Stallion.

Une cartographie artistique : White Pony sous la loupe musicale, thématique et sonore
White Pony, ce n’est pas qu’une histoire de riffs ou de beats savamment posés. C’est avant tout une épopée chromatique où chaque morceau fonctionne comme une vignette d’univers parallèle. Le style musical du disque déroute par sa propension à télescoper les genres : la colonne vertébrale du nu metal n’y survit que par bribes, vite recouverte par des nappes électroniques, des chants vaporeux et des ambiances d’un post-rock défiguré.
La voix de Chino Moreno s’y déploie comme un instrument supplémentaire, oscillant entre psalmodie et hurlement, murmurant l’angoisse et la tendresse dans la même mesure. Les paroles, souvent cryptiques, jouent sur la matière du rêve, de la violence sublimée, du désir contenu. La tension corporelle affleure, mais c’est le danger qui rôde derrière chaque allusion : sexualité, isolement, perte d’identité – autant de thématiques que l’album aborde sans jamais se dévoiler trop frontalement. Change (In the House of Flies) résume cette esthétique furtive, s’imposant davantage par le malaise qu’il distille que par la brutalité du propos.
Les arrangements, quant à eux, font voler en éclats les structures classiques. La basse de Chi Cheng gronde sous la surface, bardée d’effets, tandis que les guitares de Carpenter alternent lourdeur aqueuse et envolées dissonantes. La batterie de Cunningham, nerveuse et imprévisible, rappelle parfois l’approche jazz du free-rock, accentuant la nature mobile de chaque morceau. Frank Delgado, discrètement, insuffle des samples, des loops, parfois à la limite de l’audible, générant un sentiment d’étrangeté continue.
Écoute fragmentée, identité polymorphe
Impossible de réduire White Pony à une esthétique unique. L’album alterne entre rêve et cauchemar, sensualité et violence, sans jamais céder au manichéisme. Street Carp, Feiticeira ou Knife Prty dessinent une cartographie où le rock expérimental devance une posture, non un effet de mode.
L’écoute attentive révèle une somme d’influences savamment digérées : traces de shoegaze, relents de trip hop, bol d’air de screamo, le tout fondu dans ce que Deftones appelle sobrement « notre son ». Le groove y côtoie la dissolution, la mélodie s’embourbe parfois pour mieux ressurgir. À chaque passage sur la platine, l’album offre un visage nouveau. Voilà l’une des raisons de la longévité de ce disque venu d’ailleurs.
Sortie et réception : White Pony, l’ovni sonore face à la scène musicale de 2000
Quand White Pony atterrit dans les bacs en juin 2000, l’industrie attend fébrilement un troisième acte nerveux. Mais Deftones, fidèle à sa réputation de franc-tireur, signe un disque à rebours de la tendance formatée du nu metal. Les critiques sont prises de court : fini le refrain immédiat, place à des compositions labyrinthiques, des textures épaisses et une atmosphère volontairement opaque. Le magazine américain Rolling Stone concède un souffle d’originalité dans cette scène alors saturée de clones. Pitchfork y décèle nocivement la « louche d’éther » qui teinte tout l’album.
Le public, d’abord désarçonné, finit par suivre. « Change (In the House of Flies) » squatte les playlists FM et pose les bases d’une ballade ténébreuse qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Les ventes, elles, explosent progressivement – un platine dans la musette dès juillet 2002, adoubant le groupe sur les deux rives de l’Atlantique. Les charts américains décernent à Deftones sa première consécration mainstream, mais la reconnaissance véritable se fait dans les marges : fanzines alternatifs, cercles exigeants de la musique alternative, terres inhospitalières du rock expérimental qui voyaient en ce disque un étendard d’audace refoulée.
En France, la critique s’extasie plus tardivement : Les Inrocks salue la séduction du « risque esthétisé », tandis qu’un dossier sur Rock Sound détaille les points de rupture entre le Deftones de 1997 et celui de 2000. L’impact sur la scène musicale hexagonale sera graduel mais durable. Les radios tardent à comprendre le phénomène, mais le bouche-à-oreille underground fait son œuvre, installant White Pony comme album emblématique des années charnières.
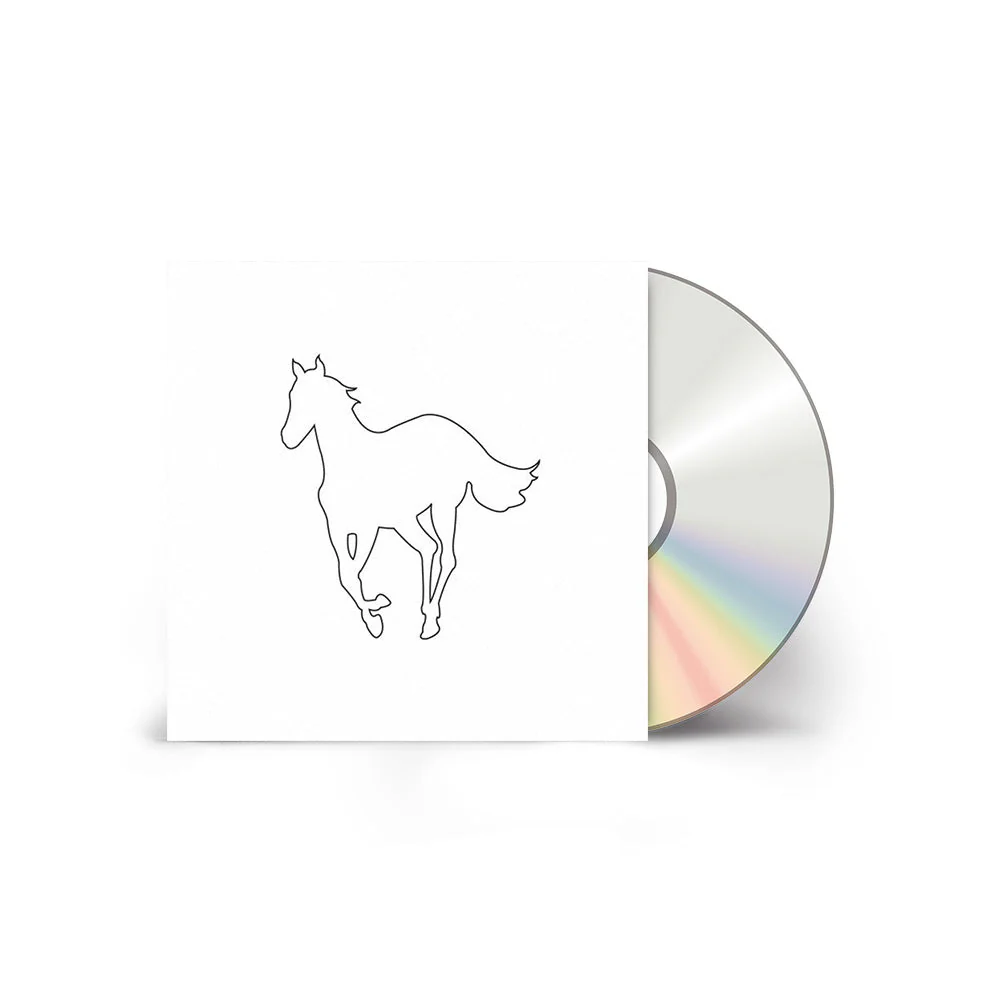
White Pony, le succès sans la compromission
Le triomphe commercial de White Pony ne s’est pas fait au prix d’un lissage du propos. Bien au contraire : Deftones a choisi de plonger plus profondément dans la noirceur, l’ambiguïté, la finesse sonore. Un choix payant, ou plutôt gagnant à retardement. White Pony gagne au fil du temps la réputation d’album clé de toute une génération et inspire quantité d’artistes alternatifs sur les vingt années suivantes.
Difficile de citer un disque aussi respecté chez les amateurs de metal expérimental et de musique alternative que chez les fans de hip-hop ou d’électro. La preuve : vingt ans plus tard, Black Stallion, recueil de remixes, accueille aussi bien DJ Shadow que Mike Shinoda de Linkin Park, ou Robert Smith de The Cure, chacun prêt à tordre l’ADN de White Pony dans une direction inédite. D’autres albums, comme « Ohms », viendront plus tard, renforcer cette image d’un groupe inclassable, jamais là où on l’attend.
White Pony et la grande reprogrammation de la scène alternative
Quelque chose bascule en 2000, une fois White Pony diffusé dans le sang de la scène musicale mondiale. Le nu metal agonise, digérant mal sa propre caricature. Sur les cendres, Deftones pose les premières pierres d’un nouveau rock alternatif, à la fois plus impur et plus sophistiqué. Le disque inspire bientôt une cohorte de groupes : Linkin Park, s’engouffrant dans la brèche ouverte entre métal et électro ; Muse, qui reprendra certaines ambiances claires-obscures ; et jusque dans le Hip Hop de Clams Casino ou le rock électronique de Phantogram, le spectre de White Pony rôde encore.
L’impact se mesure en répliques sismiques chez les producteurs – les nouveaux venus se demandent comment sculpter un album qui tienne la dragée haute à ces arrangements torturés. Des bootlegs circulent, des sessions pirates sont écoutées dans des sous-sols, tandis que la critique continue de disséquer la portée de White Pony dans ses annales. À chaque nouvelle réédition, l’étendue de son influence s’accroît. C’est toute la scène musicale, pas uniquement le nu metal, qui doit réapprendre à respirer après cette déflagration.
Ceux qui cherchent un témoignage vivant pourront se plonger dans le documentaire « Entertain Me: A Film About Deftones » – capsule temporelle captant les doutes, les joies et l’insolence créatrice de la bande californienne. Ce documentaire s’érige, comme une stèle dressée sur les ruines d’une époque, rappelant que la véritable postérité des œuvres n’est jamais immédiate – elle sédimente lentement, jusqu’à devenir l’humus d’une génération nouvelle de musiciens.
Les membres de Deftones et la constellation créative derrière White Pony
Rien de tel qu’une bonne querelle de groupe pour créer l’étincelle. En 2000, les cinq Deftones évoluent entre admiration mutuelle et compétition féroce. Chino Moreno, figure énigmatique, écrit à l’encre du ressentiment et de la fascination malsaine. Stephen Carpenter, bûcheron du riff, refuse tout compromis, repoussant sans cesse les limites du matériel sonore. Abe Cunningham, pilier rythmique, développe une frappe aussi précise qu’imprévisible, oscillant entre tempête et accalmie.
Chi Cheng, absent trop tôt, symbolise la profondeur occulte de la basse, distillant une lourdeur et une mélancolie sans laquelle White Pony n’aurait pas eu cette texture sous-jacente. Frank Delgado, dernier arrivé, trouve sa place en injectant une modernité électronique essentielle, ouvrant une brèche vers la musique alternative d’après 2000. La diversité de ces caractères nourrit les tensions, mais lorsqu’ils fusionnent dans le studio, c’est l’alchimie pure – le tout est supérieur à la somme des individualités.
Les invités ne sont pas en reste : sur « Passenger », la présence de Maynard James Keenan, chanteur de Tool, offre un contrepoint hypnotique à Chino Moreno. Cet échange de voix entremêlées constitue l’un des sommets de l’album, condensant tout l’art du dialogue non verbal et de la poésie cryptique propre à White Pony.
Interactions, fêlures et éclosions
Le collectif Deftones fonctionne comme une meute de loups attachée à ses divergences. La complémentarité ne va pas sans friction, et les sessions de studio sont souvent rythmées par les joutes verbales entre Moreno et Carpenter – l’enjeu étant de ne pas céder à la facilité mais d’avancer, d’explorer, de risquer l’erreur. C’est cette dynamique conflictuelle qui, paradoxalement, donnera naissance à la cohérence – fissurée mais tenace – de White Pony.
Presser ce disque aujourd’hui, c’est approcher un artefact où chaque musicien a laissé une empreinte, une blessure, un écho. L’héritage du groupe repose sur cet équilibre instable, cette danse sur le fil du rasoir, qui évite à White Pony la routine aseptisée des albums calculés. Ici, le vivant déborde toujours, même à travers le grésillement du vinyle ou la compression sans âme du MP3.
Rééditions, remixes et concerts : White Pony, une éternelle redécouverte
Disque mutant, White Pony n’a de cesse d’échapper à la pétrification. La réédition de 2020, accompagnée du Black Stallion tant fantasmé, propose une plongée dans la matrice du disque. Outre la rénovation sonore, ces éditions multiplient les supports : coffrets vinyles montagneux, CDs ornés d’inédits, lithographies collector. Deftones sait flatter la fibre collectionneur, tandis que les remixes viennent rebattre les cartes de l’écoute.
Les concerts fêtant l’anniversaire de White Pony prennent souvent la forme de rétrospectives, où le groupe réinterprète une grande partie du disque – parfois dans l’ordre, parfois dans le désordre, ne résistant jamais bien longtemps à l’envie de bouleverser la setlist. L’interprétation live, moins clinique que l’album, conserve cette tension organique qui caractérise le groupe. Les fans, devenus familles, retombent dans ce vortex sonore, oscillant entre nostalgie et redécouverte.
Certains bootlegs capturent même des versions alternatives, où la fatigue ou l’euphorie donnent naissance à des variantes intéressantes. Loin de figer le répertoire, ces prestations prolongent l’aura trouble de White Pony, renforçant la légende mouvante qui enveloppe le disque.
Black Stallion, laboratoire de postérité
Black Stallion, véritable pierre angulaire dans la stratégie de réinvention permanente, regroupe des artistes issus des marges du hip hop, de l’électronique, du rock indépendant. Ce disque se veut la suite logique de l’aventure initiée vingt ans plus tôt. Les relectures de DJ Shadow, Squarepusher, Phantogram ou Robert Smith témoignent du caractère transversal de White Pony, capable encore, deux décennies plus tard, de fédérer des créateurs venus d’horizons opposés.
Ce carrousel d’hommages et de transformations permet à l’album de continuer sa route, insaisissable mais terriblement vivant, sur une scène alternative qui s’est largement diversifiée. Les rééditions, loin de représenter une fin, jalonnent ainsi le parcours de Deftones, qui refuse obstinément de s’enfermer dans le rôle du groupe culte figé dans l’ambre des souvenirs.
Et dans ces versions alternatives, c’est peut-être encore ce que Deftones sait faire de mieux : remettre le feu à la plaine là où on ne l’attend plus.
White Pony autopsié : tracklist, musiciens et détails techniques
| N° | Titre | Auteur(s) | Compositeur(s) | Interprète(s) | Musiciens notables | Durée | Date d’enregistrement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feiticeira | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 3:09 | 1999-2000 |
| 2 | Digital Bath | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 4:15 | 1999-2000 |
| 3 | Elite | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 4:01 | 1999-2000 |
| 4 | Rx Queen | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers), Scott Weiland (backing vocal) | 4:27 | 1999-2000 |
| 5 | Street Carp | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 2:42 | 1999-2000 |
| 6 | Teenager | Moreno, Delgado | Deftones, Delgado | Deftones | Moreno (chant), Delgado (beats, programming), Carpenter (guitare), Cunningham (batterie) | 3:20 | 1999-2000 |
| 7 | Knife Prty | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers), Rodleen Getsic (guests vocals) | 4:49 | 1999-2000 |
| 8 | Korea | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 3:23 | 1999-2000 |
| 9 | Passenger | Moreno | Deftones | Deftones feat. Maynard J. Keenan | Moreno (chant), Maynard J. Keenan (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 6:08 | 1999-2000 |
| 10 | Change (In the House of Flies) | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 4:59 | 1999-2000 |
| 11 | Pink Maggit | Moreno | Deftones | Deftones | Moreno (chant), Carpenter (guitare), Cheng (basse), Cunningham (batterie), Delgado (claviers) | 7:32 | 1999-2000 |
Perspectives, héritage et actualité : Deftones, toujours à contre-courant
À l’heure où beaucoup rangent la musique alternative au rayon vintage, Deftones continue d’incarner la permanence de l’imprévisible. Depuis la parution du neuvième album « Ohms », le groupe multiplie les incursions dans les festivals et les collaborations inattendues, refusant le repos du guerrier. En 2020, la réédition de White Pony avec Black Stallion scelle le pacte d’un collectif qui se rêve éternel laboratoire. C’est cette capacité à refracter les époques pour les modeler qui inscrit Deftones à part dans la scène musicale contemporaine.
L’héritage du groupe ne réside pas tant dans la longévité que dans l’abnégation : Deftones a toujours évolué à contre-courant, ignorant les sirènes du mainstream, sans jamais se contenter du statut de groupe culte. Leur influence, observable dans les travaux des nouvelles pousses du rock expérimental et du nu metal revisité, confirme une chose : White Pony a accéléré une mutation qui n’est toujours pas achevée. Il suffit de parcourir les classements annuels retraçant l’évolution du genre sur Rocksound.fr pour mesurer l’ampleur du sillon creusé dans la mémoire collective.
Deftones, insaisissable formation en état de réinvention permanente, a su concilier malaise existentiel et fascination sonore. White Pony n’est pas une relique d’époque mais un pont jeté vers l’avenir. Sur la scène musicale de 2025, nul ne saurait se vanter d’avoir totalement sondé son mystère. Le cheval blanc galope, encore et toujours – sans attaches, sans clôture, sans fin.
Pour continuer l’exploration et consulter la discographie du groupe, rendez-vous sur leur Site officiel.
FAQ sur Deftones et l’impact de White Pony
White Pony a bouleversé la scène nu metal en injectant des influences expérimentales, électroniques et alternatives. Il a contribué à décloisonner les genres, ouvrant la voie à des groupes hybrides tout en restant une référence pour la musique alternative et le rock expérimental.
Chino Moreno (chant, textes), Stephen Carpenter (guitare), Abe Cunningham (batterie), Chi Cheng (basse) et Frank Delgado (platines, claviers) forment le noyau créatif. Des invités comme Maynard James Keenan (Tool) ont amplifié l’aura de l’album.
Oui, la réédition pour le 20e anniversaire inclut « Black Stallion », un disque de remixes avec des artistes comme DJ Shadow, Robert Smith, Mike Shinoda, Phantogram, retraçant l’héritage du groupe dans l’électro, le hip-hop et le rock expérimental.
White Pony synthétise l’innovation stylistique de Deftones : mariage de force brute et d’atmosphères vaporeuses, textes ambigus, production moderne et impact profond sur la scène musicale, inspirant des générations d’artistes alternatifs.
White Pony a bouleversé la scène nu metal en injectant des influences expérimentales, électroniques et alternatives. Il a contribué à décloisonner les genres, ouvrant la voie à des groupes hybrides tout en restant une référence pour la musique alternative et le rock expérimental.