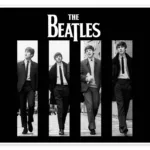Plongez dans les coulisses chaotiques et électrisantes de l’industrie musicale new-yorkaise des années 70 avec Vinyl, la série HBO créée par Martin Scorsese et Mick Jagger. Sexe, drogue, rock’n’roll, et renaissance artistique : suivez Richie Finestra, producteur de disques au bord du gouffre, dans une quête effrénée pour ressusciter son label au cœur d’une époque en pleine révolution sonore. Quand le glam croise le punk, et que les vinyles tournent plus vite que les vies s’effondrent, le spectacle ne fait que commencer…

VINYL
Vinyl : chronique d’un naufrage rock’n’roll
Le pitch : Durant la première moitié des années 70, nous suivons le parcours de Richie Finestra (interprété par Bobby Cannavale, acteur scorcesien récurent). Richie est un producteur de rock originaire de Brooklyn qui “s’est fait tout seul”. En pleine crise de la quarantaine, miné par une très forte dépendance à la drogue, il décide soudain de faire renaitre de ses cendres son label moribond en allant chercher de nouveaux styles de musique, principalement un style de rock beaucoup plus percutant et direct, amené à faire oublier les boursoufflures du moment…
Le Rock en quête d’une nouvelle dignité
D’entrée de jeu, VYNIL n’est pas une série exempte de clichés. Et le rabâchage chronique, qui consiste à décréter que le rock doit être “comme ci et pas comme ça”, et notamment crade, rugueux et sans fioritures pour être crédible et sincère, est cristallisé dans une scène de l’épisode 3, lorsque Richie entre dans son studio, entend un disque de Jethro Tull en s’écriant “C’est quoi cette merde ?!!!”, avant de casser le disque en mille morceaux et d’aller s’extasier devant un groupe représentant le prototype du proto-punk (The Nasty Bits, groupe fictif inventé pour l’occasion), sorte de chainon manquant entre les Stooges, les Ramones et autres Sex Pistols. Plusieurs décennies après l’avènement du punk, cet état d’esprit sent désormais la naphtaline.
Nonobstant, c’est un peu comme ça que ça s’est passé, à l’époque : les rockers avaient l’impression que leur truc s’était dénaturé, et ils voulaient lui redonner un blason de dignité. Chacun décidera de si c’était une bonne idée, ou pas… mais en tous les cas, il est clair qu’à partir de là les choses allaient changer…
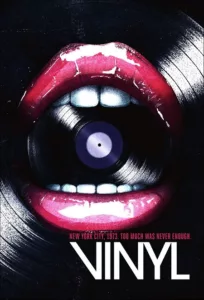
VINYL : Ça se voit que c’est produit par Mick Jagger ?
Mick Jagger et Martin Scorcese aux commandes
Dotée d’un budget pharaonique de 100 millions de dollars (dont 30 pour le seul pilote), la première saison échouera néanmoins lamentablement puisque HBO décidera de tout stopper au terme du dixième épisode.
Cet échec est généré par plusieurs éléments. Au départ, le projet était né de Mick Jagger lui-même, qui rêvait d’une grande fresque cinématographique sur l’histoire du rock et plus précisément sur celle des années 70, au moment où le visage du rock a changé au détriment des grands groupes installés et au bénéfice des nouveaux rockers décidés à revenir à quelque chose de beaucoup plus direct. Et le chanteur des Stones ne voyait qu’un seul réalisateur pour ce projet : Martin Scorcese et personne d’autre !
Initialement baptisé THE LONG PLAY, le projet de Jagger commence à prendre le visage d’un grand film de trois heures, illustrant les bouleversements musicaux qui accompagnent l’Amérique de Nixon, lorsque survient la grande crise financière mondiale de 2008. Tout l’édifice s’écroule et sa gestation ne sera reprise que plusieurs années plus tard, cette fois sous la forme d’une série TV qui demeurera inachevée. Comme quoi, quand ça veut pas…
L’autre souci vient du fait que Scorcese s’entête à ne réaliser que le pilote, comme il l’avait fait pour la série BOARDWALK EMPIRE en 2010. Il le reconnaitra trop tard : S’il avait réalisé tous les épisodes, le bonhomme reste persuadé que jamais HBO n’aurait osé annuler VINYL et qu’il aurait pu imposer ses désidératas, à la manière de David Lynch sur la troisième saison inespérée de TWIN PEAKS.
L’industrie musicale en quête de ses nouveaux héros
VYNIL n’est donc que l’oripeau d’un rêve et la partie émergée d’un iceberg perdu pour toujours. Il en reste pourtant une petite série d’épisodes débridés, franchement rafraichissants.
Malgré les clichés relevés plus haut, l’ensemble est tellement bien fait qu’on peut objectivement épouser cette envie de changement éprouvée par les amoureux du rock dans ce milieu des années 70. Le personnage de Richie, c’est un peu l’équivalent d’un journaliste comme Nick Kent qui ne supporte plus de voir ces stars du rock qui s’embourgeoisent dans la jet set en produisant des albums de plus en plus mous, tandis que l’énergie première du genre semble avoir disparu au profit d’un star system corrompu et dirigé par la mafia à coup de milliards de dollars.
La scène emblématique de cette prise de conscience marque le final de l’épisode pilote. Arrivé par hasard au milieu d’un concert des New-York Dolls dans le sous-sol d’un vieil immeuble new-yorkais, Richie prend en pleine face la rage de ce rock primitif lorsque le bruit assourdissant du groupe fait s’écrouler tout l’immeuble. À son réveil, lorsqu’il sort des décombres tel un survivant de l’apocalypse, Richie prend l’événement comme une révélation sur la véritable puissance d’un rock débarrassé de ses carences obsolètes !
De retour dans son studio, Richie harangue ses troupes et menace de virer tous ses employés (parmi lesquels on reconnait le jeune Jack Quaid – fils de Dennis Quaid et Meg Ryan – qui interprètera bientôt le personnage de Hughie dans la série THE BOYS) s’ils ne lui ramènent pas le plus vite possible de nouveaux groupes de rock qui ont la niaque, au moment où son label prend l’eau juste après avoir raté un contrat juteux avec Led Zeppelin qui, de leur côté, ont banané Richie en créant dans l’ombre leur propre maison de production !
DES STARS DU ROCK BIEN LISSES
L’anecdote avec Led Zep est réelle (ils ont bel et bien arnaqué tout le monde en créant leur propre label sous la houlette de leur manager, le terrible Peter Grant, qui terrorisait toute la profession en jouant de bourres-pif et de menaces de procès en tout genre !) et illustre bien le projet de la série, qui tisse l’histoire fictive de Richie Finestra pour mieux raconter l’histoire réelle du rock en ce milieu des années 70.
Le spectateur assiste donc, tout au long de VINYL, à des rencontres avec les stars du rock de l’époque, toutes mimées par des acteurs jouant les faux sosies en caricaturant gentiment toute une armée de rockers, de personnalités ou de musiciens célèbres, comme Robert Plant, Alice Cooper, David Bowie, John Lennon, Bob Marley (et Peter Tosh) ou encore Andy Warhol…
Les acteurs incarnent des stars du rock incroyablement lisses, très loin de leur charisme légendaire, mis à part Bowie, interprété par un sosie assez saisissant dans un épisode directement dédié à sa mémoire. La palme de la désacralisation revient à Elvis, mis en scène dans une chambre d’hôtel comme un pauvre type bedonnant et pathétique sous l’emprise de son manager le Colonel Parker (de nouveau un cliché, les puristes du “rock intègre” ayant décidé, pour la plupart, que le King n’était plus que l’ombre de lui-même dans sa “période Las Vegas”). Un parti-pris qui semble clairement claironner que les vrais héros de VINYL sont avant tout les producteurs, les managers et les nouvelles étoiles du rock dénichées par Richie et ses sbires, toutes fictives pour le coup. Le leader du groupe proto-punk The Nasty Bits est quant à lui interprété par James Jagger (fils de Mick Jagger et Jerry Hall), qui fait ici des débuts assez convaincants en incarnant un punk plus vrai que nature, à côté duquel toutes les stars ayant réellement existé semble être de vrais polichinelles !
Une immersion dans le New-York des 70’s
Il demeure avant tout un voyage en première classe au cœur des années 70, la plus grande décennie de l’histoire de la musique moderne. Le spectateur évolue au plus près du New-York des 70’s dans les rues, les clubs, les studios et les divers endroits de la Grande Pomme. Comme intégré au temps et à l’espace, tout décoré de marron et d’orange, il pourrait presque sentir les odeurs de patchouli, le goût de la cocaïne, la fumée des clubs et la sueur des dancings, le frottement des pattes d’éléphant en velours sur les meubles en formica et les tapis en astrakan.
Il voit émerger sous ses yeux tous les nouveaux courants musicaux de la décennie en question au rythme d’une bande-son extraordinaire : le punk rock, certes, mais également le disco, le reggae et même les disc-jockeys qui feront bientôt la pluie et le beau temps pour ce qui est de la promotion des disques en vue. Il suit les protagonistes dans le piège que représente à l’époque l’accès à toutes ces substances psychotropes, substances qui sont en train d’enterrer les idéologies de la décennie précédente dans la réalité crue de la déchéance. Au bout du compte, le spectateur voit le monde muter vers un avenir plus sombre encore, plus concurrentiel, implacable et violent.
Et le disco ? Heureusement qu’une des meilleurs scènes de la série vient nous rappeler que c’était cool !
Une histoire sans fin…
Le plus gros défaut de l’ensemble demeure son ventre mou. Non pas que les épisodes soient longuets, puisqu’ils sont au contraire dynamités par une frénésie cocaïnée permanente (on pense souvent à la série CALIFORNICATION pour le cocktail déjanté et explosif), mais parce qu’ils rabâchent sans cesse le même crédo : Richie et ses collaborateurs ne réussissent jamais leurs objectifs tant ils sont perchés et prisonniers de leur mode de vie lié à la défonce et aux mauvais choix qui en découlent. Ils font systématiquement tout échouer et, à chaque fois que le spectateur sent enfin arriver le moment où l’un de leurs poulains va émerger et sauver le studio, tout s’écroule, de plus en plus lamentablement !
Cet imbroglio qui voit le personnage principal et ses proches s’enfoncer chaque fois un peu plus bas dans les affaires de drogue, de mafia, de meurtres, de trahisons et de mœurs sordides, finit par desservir VINYL à force de s’étirer sans cesse. Impossible, arrivé à l’épisode 10 final, de ne pas se rendre compte que tout aurait pu tenir en moitié moins d’épisodes et que toute l’histoire aurait pu être bouclée en une seule saison ! C’est clair : En essayant d’étirer leur concept, les showrunners se sont tiré une balle dans le pied…
L’épisode final ne constitue en rien une fin claire, la plupart des intrigues restant en suspens. Pour autant, il ne s’achève sur aucun cliffhanger, atténuant la frustration du spectateur, qui se contente ainsi d’une fin ouverte…
Reste ce voyage dans le temps, pour le coup ici plus important que la destination, rondement mené et interprété, qui illustre merveilleusement bien toute une époque, tout un lieu et toute une faune indissociable de l’histoire du rock et de la musique du XXème siècle.
Serait-ce enfin l’heure de gloire pour les Nasty Bits ?