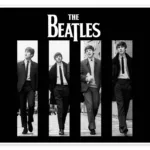Quand le ciel britannique s’assombrit pour révéler un Absolution, on se doute que le rock traversait une sale période de disette créative, à l’orée des années 2000. Pourtant, Muse, trio tout droit débarqué du Devon avec une élégance névrotique et une propension à en faire des tonnes, délivre—fin 2003—un album de trente étoiles filantes. Entre échos anxiogènes post-11 septembre, grandiloquence musicale à la sauce Queen revisitée par la génération Pro Tools, et poésie sur couche d’asphalte, Absolution n’est pas qu’une collection de riffs.
C’est l’auto-psychanalyse d’un groupe érigé en étendard d’une jeunesse qui, entre MTV, EMI et Warner Music, cherche encore sa catharsis. Dans cette fresque où la peur le dispute à l’exaltation, chaque accord résonne comme une injonction à ouvrir les fenêtres, quitte à aérer un peu la poussière accumulée dans les recoins du rock alternatif britannique.
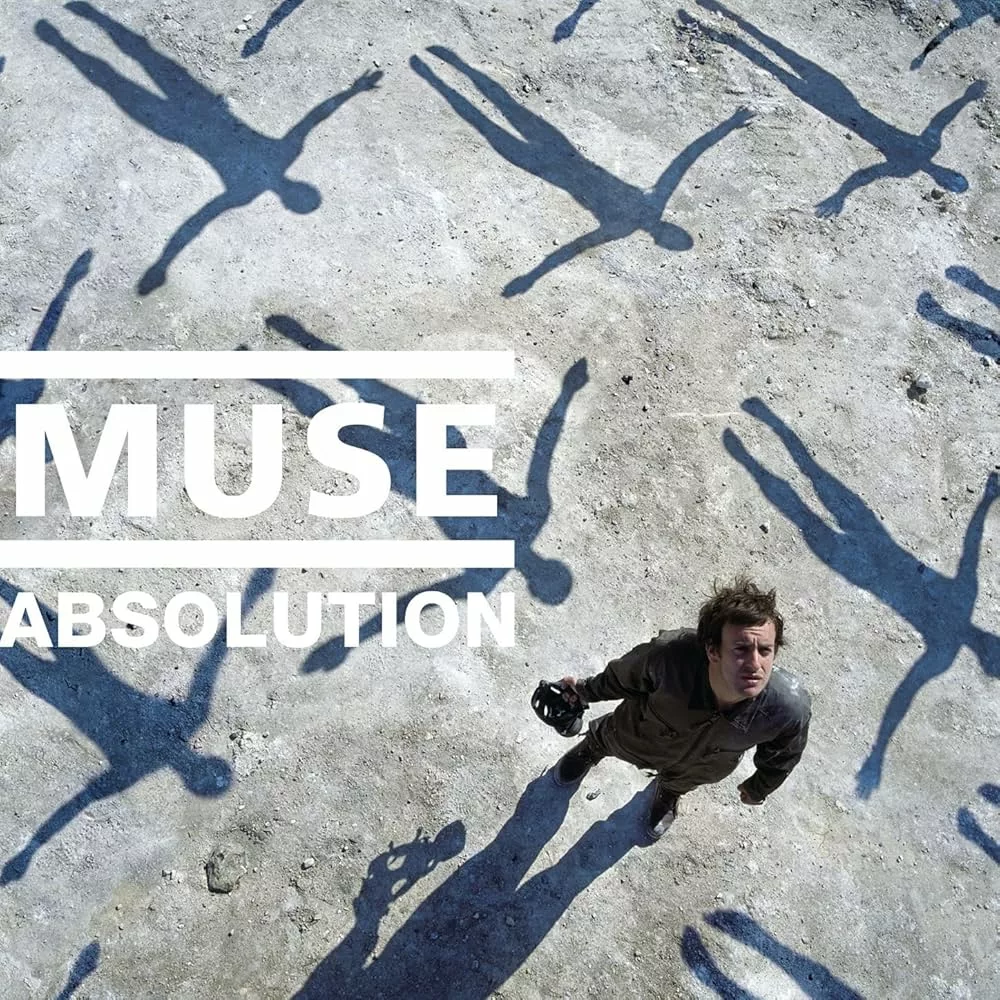
Muse Absolution
Contexte historique et naissance d’Absolution : Muse débarque dans l’après 11-Septembre
On est en 2002. Le monde de la musique anglo-saxonne patauge dans l’incertitude, la gueule de bois post-grunge n’a rien arrangé. Muse, échappé de ce Devon brumeux, déploie une vision apocalyptique qui aurait réjoui Ray Bradbury bourré à l’absinthe. Ce n’est pas seulement la peur diffuse qui flotte sur l’Occident—attentats, menaces existentielles et invasion U.S. en Irak—, c’est un soupçon d’urgence chez tous les groupes qui, à l’époque, tentent d’électrifier l’angoisse collective. Dans ce décor où Radiohead s’enferme dans la spirale de Kid A, où Coldplay politise sa mélancolie, Muse cherche à donner de la voix. Façon de crier plus fort que Thom Yorke ou Chris Martin, histoire d’imposer une église baroque dans le désert indie.
L’avènement d’Absolution, c’est aussi la confirmation que Muse devient enfin patron dans son propre délire. Après Showbiz et Origin of Symmetry, Matthew Bellamy et ses deux acolytes—Dominic Howard et Chris Wolstenholme—rêvent de balancer l’Angleterre dans un marasme orchestral. Une époque où l’on parle encore de Warner Music comme d’une hydre sans âme et où les labels type Harmonia Mundi rêvent d’un retour en grâce du progressif. Pas la peine d’en faire des caisses, il y a dans l’air quelque chose de brisé, de tremblant et d’effrontément lyrique—exactement la substance qui infuse Absolution jusque dans ses moindres respirations. Pour cerner l’esprit de l’époque, il suffirait de se rappeler les hystéries devant les micros de Sonic ou d’Universal Music : on voulait à nouveau des hymnes, pas des chimiques club bangers. Muse prend donc le contre-pied, entre hymnes dystopiques et envolées wagnériennes.
La gestation d’Absolution doit aussi beaucoup à la scène rock britannique qui se cherche désespérément une colonne vertébrale dans ce début de XXIe siècle. Oasis commence sérieusement à radoter, Radiohead poursuit sa fuite vers l’avant, The Libertines préfèrent se shooter sur les toits que d’enregistrer un disque lisible, bref, le terrain est libre pour une prise de pouvoir sonique. Muse sent cette brèche et s’y engouffre à la hussarde, sans complexes ni inhibition, jouant l’excès et la démesure comme des arguments existentielles, et non pas comme de simples postures marketées.

Muse Absolution
Il y a aussi la pression sourde mais tenace des fans et des critiques, déjà polarisés par le parcours du groupe. Alors que certains leur collent volontiers l’étiquette de sous-Radiohead ou d’ersatz Queen sous amphètes, Muse n’a que faire de ces piques. Absolution doit être, et sera, un manifeste grandiloquent, une réponse frontale à la tiédeur rampante du rock mainstream du moment, et surtout, l’acte de naissance d’un style propre, identifiable au premier crash de cymbales. La terreur, la joie, la transcendance et même la paranoïa : voilà les carburants du triptyque Bellamy, Wolstenholme, Howard pendant cette gestation artistique pleine de vertiges à la Charles Baudelaire et d’aspirations à la dystopie science-fictionnesque. Le tout mis en son dans une Angleterre qui regarde nerveusement le journal de 20h, entre deux singles des White Stripes.
Des influences éclatées dans un paysage musical saturé
Certains affirment que Muse, à cette époque, n’était finalement qu’un melting-pot de ses influences, du classicisme Queen à la nervosité de Rage Against the Machine. Mais Absolution marque un coup de semonce. Fini les clins d’œil appuyés, place à la synthèse sauvage, à ce goût pour le grand mélange des genres que résume l’album : rock alternatif, progressif, symphonique, hard, art-rock—un arc-en-ciel, ou plutôt un orage de décibels. Absolution, c’est une pierre jetée dans la mare de la normalisation pop, qui, par ironie amère, sera vite récupérée par tous les médias, qu’ils s’appellent MTV ou NME. Un paradoxe déjà à la saveur douce-amère d’une époque où la singularité se consomme comme un yaourt bio à la cafétéria du coin.
L’impact contextuel d’Absolution, aussi, c’est ce moment précis où Muse cesse d’être un “groupe à suivre” pour devenir l’un de ces épouvantails que les critiques anglais encensent ou assassinent dans l’heure. Au fond, ce disque n’est pas tant un album qu’un miroir, tendu à l’Angleterre du début des années 2000. Pas d’angélisme, pas de minimalisme. Juste une injonction à vivre grand et à mourir plus fort encore.

Muse Absolution
Enregistrements en roue libre et choix artistiques radicaux durant la création de l’album
L’enregistrement d’Absolution se déroule sur près d’un an. Ce n’est pas tout à fait Abbey Road, mais à force d’arpenter les couloirs du Sawmills Studio en Cornouailles, puis Grouse Lodge (au fin fond de l’Irlande), et enfin quelques incursions en Californie à Los Angeles, la bande de Muse accouche d’un monstre. Cette mobilité géographique n’a rien d’un caprice de rock-stars en mode EMI-gold, c’est le moyen—ultime—de parfaire chaque atmosphère, chaque goutte de réverbération sur le clavier d’Apocalypse Please.
Avec Rich Costey à la baguette et John Cornfield dans les parages, on tient là deux producteurs capables d’inciter Bellamy à se jeter tête la première dans de savants déluges de sons, tout en ramenant le trio sur terre lorsque l’excès menace de les faire planer à dix mille pieds. Paul Reeve, déjà complice sur Origin of Symmetry, refait surface pour ajuster quelques détails, comme le vernis final sur une carrosserie de bolide anglais prêt à dévorer la route.
On murmure même que certains titres, Hysteria par exemple, auront pissé l’huile pendant des jours en studio, le groupe cherchant LA ligne de basse qui ferait exploser les enceintes de Sony, Universal Music ou même Harmonia Mundi dans chaque bagnole décatie d’étudiant britannique.
On se marre souvent à l’évocation de l’absence de limites. Mais pour Absolution, c’est le cas : Muse prend le temps de polir chaque riff, d’organiser des réunions de travail à minuit pour coller aux humeurs de Bellamy, d’aller chercher un orchestre de 18 instruments pour Blackout, sans parler des nuits passées à accorder le piano jusqu’à le faire pleurer lui-même. Ce n’est plus de la musique, c’est de la chirurgie esthétique sur partition, et le moindre détail est trituré jusqu’à l’os, quitte à agacer le pauvre ingé-son à deux doigts de l’incendie mental.
Anecdotes de studio : les révélations derrière l’album Absolution
En studio, la tension grimpe parfois d’un cran lorsque Bellamy s’écharpe avec Wolstenholme sur la place de la basse dans Hysteria. Le groupe embauche même un arrangeur de cordes pour Butterflies and Hurricanes, histoire de transcender l’esthétique simple du trio vers une fresque à la Wagner. L’effet recherché : abolir la frontière entre rock et classique, comme si le bon goût avait quitté la pièce pour laisser place au chaos sublime. Des rumeurs, plus ou moins fondées, affirment que chaque prise vocale était précédée d’un shot de whisky pour assécher la rage de Bellamy. Quoiqu’il en soit, les conditions laxistes (cette fois sans deadline ni pression des labels comme Warner Music ou Naïve) permettent une liberté inouïe, propice à l’inventivité.
Le mixage, point final de ce marathon artistique, se déroule à Los Angeles, loin de la grisaille anglaise. Là, les détails sont peaufinés jusqu’à l’obsession, les pistes empilées à la façon des albums mythiques. Ce perfectionnisme obsessionnel deviendra la marque de fabrique de Muse, comme un clin d’œil à l’indépassable manie de Pink Floyd ou Led Zeppelin dont Storm Thorgerson—créateur de la pochette—est déjà coutumier.
Analyse musicale d’Absolution : styles, thématiques et expériences sonores
Impossible de parler d’Absolution sans évoquer sa diversité stylistique. Dans cet album, Muse fait exploser le carcan du rock anglais à grand renfort de morceaux protéiformes. Rock alternatif, hard rock, progressif, lustré d’art-rock et même d’incursions électro : on navigue entre différents fleuves sans toucher terre. Time Is Running Out et Hysteria affichent les muscles, avec une section rythmique lourde, des distorsions ciselées et des refrains tout droit sortis d’un opéra pour robots surmenés.
Croiser une telle explosion sonore, c’est un peu comme retrouver la trace d’un riff de Black Sabbath venu s’échouer dans la caverne d’Ali Baba de Queen, le larsen en plus, le kitsch assumé de moins. Les transitions entre titres abruptes, parfois volontairement déstabilisantes (stockholm syndrome, Interlude), témoignent d’une volonté farouche de bousculer l’auditeur, sans jamais lui laisser reprendre son souffle. Chose rare sous MTV à l’aube du XXIe siècle, où l’on formate la pop et on oublie que les tripes peuvent aussi s’exprimer en mineur.
Les paroles, quant à elles, frisent une poésie de l’apocalypse. On y parle de fin du monde, de trahison, mais aussi d’affirmation et de jouissance. C’est une succession de visions hallucinées, de prophéties auto-proclamées. Ruled by Secrecy plane comme une menace, tandis que Sing for Absolution tente l’incantation lyrique sur tapis de guitares rehaussées par des nappes de claviers cliniques. Bellamy sort l’artillerie lourde, oscillant entre falsetto à la Mercury et accès de rage quasi-messianique.
Instrumentation, arrangements et production : la démesure calculée
L’histoire retiendra forcément la basse monstrueuse de Wolstenholme sur Hysteria. Un modèle de violence contrôlée, aussi iconique pour l’époque que la batterie tribale de Dominic Howard sur Apocalypse Please. Le piano néo-classique, injecté en pleine veine de Butterflies and Hurricanes, donne le ton d’une ambition qui mélange tout : groove, rock, orgue, orchestre symphonique. Mention spéciale aussi à Blackout, qui s’arme de cordes et de chœurs pour mieux tourner en ridicule la notion même d’économie dans le rock—Muse n’en a rien à battre de la retenue, et c’est tant mieux.
Les expérimentations ne manquent pas. Endlessly flirte avec les automatismes électroniques, une sorte de clin d’œil (volontaire ?) à une époque où Universal Music tente encore de faire danser du rock avec des boîtes à rythmes. Thought of a Dying Atheist et The Small Print, dans un registre plus offensif, exhibent une rythmique punkifiée, carnassière, qui fait parfois penser aux excès des premières balles de Sonic Youth. Et si la grandiloquence finit par tourner à la caricature sur certaines pistes pour les puristes du minimalisme, elle séduit par effet de masse, comme le fascisme sonore d’un opéra moderne.
Au bout du compte, Absolution sonne comme un laboratoire, un authentique no man’s land où tout est permis, tout est exploré. Une invitation à baisser la garde, à accepter que la musique, surtout chez Muse, refuse obstinément de choisir entre subtilité et hémorragie sonore.
Réactions de la presse et du public à la sortie d’Absolution
Quand Absolution atterrit dans les bacs le 29 septembre 2003—labellisé Taste Media, distribué par ce patchwork de Warner Music, Naïve, Mushroom Records—le public anglais a encore la gueule de bois des grandes heures Britpop. L’album se classe illico à la première place au Royaume-Uni, bondissant aussi directement au sommet en France, démontrant que la francophonie sait parfois accueillir la grandiloquence sans ciller. Dans les bacs du Virgin Megastore, entre deux présentoirs Sonic et Harmonia Mundi, c’est l’album que les vendeurs proposent en boucle, histoire d’épuiser toutes les basses avant la fin de l’après-midi.
Rayon presse, critiques et chroniqueurs s’écharpent à qui mieux-mieux pour classer l’album : Q magazine classe Stockholm Syndrome parmi les meilleurs morceaux de guitare au monde, le NME le sacre 21e sur la liste des meilleurs albums britanniques jamais sortis. Sur Metacritic, on parle d’un solide score de 72/100 pour seize critiques—preuve qu’il n’existe pas de consensus, mais que l’honnêteté critique demeure. Le New Musical Express balance même que l’album “est rempli de miracles”—volonté de choquer ou sincère admiration, le débat fait rage dans les rédactions.
Quelques insatisfaits grondent, comme AllMusic qui lui reproche d’être moins “brut” que son prédécesseur, trouvant à redire à l’approche moins directe, plus lyrique. Rolling Stone est plus nuancé : félicite l’aisance instrumentale, tacle le chant de Bellamy, qui, paraît-il, manquerait de “personnalité”—coup de griffe, ou incapacité à saisir l’opéra contemporain ? Les éternels donneurs de leçons de PopMatters, quant à eux, y voient un album au potentiel non abouti, reprochant au groupe de “faire des promesses”, plutôt que de les tenir.
Mais pour chaque langage hostile, dix admirateurs se lèvent, à commencer par Mike Portnoy de Dream Theater qui place Absolution en haut de son panthéon personnel du XXIe siècle — reconnaissance post-moderne, clin d’œil à l’effet d’entraînement musical. La presse rock alternative française, quant à elle, dégaine les superlatifs, arguant que Muse “trouve son identité” et “réhabilite le meilleur du rock progressif”. On en oublierait presque que la presse mainstream, du style MTV ou NME, a longtemps tergiversé avant d’accepter la démesure musesque. Mais l’album, comme un serpent dans une pinte, s’immisce dans toutes les conversations, forçant l’écoute, l’adhésion, voire l’obsession chez certains auditeurs à l’âme lyrique et au cœur en détresse.
Succès commercial et chiffres clés
Déclenché par la bombe Time Is Running Out et le dynamitage sonique de Hysteria, Absolution se vend à 4.5 millions d’exemplaires dans le monde, triple platine au Royaume-Uni, platine en Australie, or au Canada et même disque d’or aux États-Unis—audace rare pour un groupe prog/alternatif jusqu’alors boycotté par les ondes US. Absolution s’incruste dans cinquante top 10 mondiaux, se classe numéro cinq, voire mieux, dans douze pays.
La longévité de l’album, aidée par la sortie différée aux États-Unis, entretient une pression permanente sur les charts, conférant à Muse ce statut de “groupe qui ne meurt jamais, mais qui renaît sans crier gare”. Et tant pis si la presse indie continue de s’étrangler : le public, lui, vote avec ses oreilles et son porte-monnaie.
Au final, Absolution, c’est le genre de disque dont la réception ne ressemble jamais à un consensus tiède mais à une guerre de tranchées, où chaque camp sort grandi d’avoir osé prendre parti. En définitive, un disque qui oblige à choisir un camp, ce qui n’est jamais anodin dans les annales du rock moderne.
Impact d’Absolution sur la scène musicale et reconnaissance au fil des années
L’influence d’Absolution s’étend au-delà des frontières britanniques. On jurerait retrouver des relents du disque aussi bien chez les têtes pensantes de la scène mondiale qu’auprès des seconds couteaux qui hantaient déjà Sonic Youth ou Mars Volta à l’époque. Le jeu de basse ciselé de Wolstenholme sur Hysteria servira d’inspiration directe au morceau Never Enough de Dream Theater—preuve, s’il en fallait, que le prog américain a les oreilles qui traînent un peu partout.
Avec Absolution, Muse offre à tous les héritiers du rock alternatif un mode d’emploi : oser la surcharge émotionnelle, sortir du carcan binaire couplet-refrain et chatouiller le public jusque dans ses retranchements. L’album devient rapidement une référence dans son genre, salué lors de maints classements de la scène alternative (voir, par exemple, les dossiers “10 albums rock qui ont marqué les années 2000” sur Rock Sound). Il n’est pas rare non plus que des groupes plus jeunes s’en réclament dans leurs interviews chez MTV ou NME, expliquant qu’ils cherchent depuis des années à retrouver la même urgence, en vain.
Remaniements, influence et héritage
On attribue à Absolution le renouveau d’un certain art-rock, celui qui n’a pas peur de frôler le ridicule en épousant la théâtralité la plus outrancière, quitte à laisser derrière lui le public des puristes indie ou grunge. L’apport structurel du disque, c’est aussi la démystification du progressif, sa mise en scène moderne, dépoussiérée, sans jamais rechigner devant les synthétiseurs ou les passages d’orchestre. Si des labels comme EMI ou Universal Music tentent (toujours en vain) de placer un second Muse, c’est bien parce que le groupe a gravé dans le marbre l’idée qu’un trio peut sonner comme une armée suréquipée, du moment qu’il est prêt à toucher la frontière du gouffre.
Et pour que l’histoire retienne la trace, il aura suffi de quelques concerts anthologiques, des enregistrements live à Sydney ou à Berlin, et d’une poignée de remix pour que Muse devienne une machine à inspirer. En témoigne le retour du groupe dans tous les classements “best-of” de la décennie, mais aussi dans les playlists les plus consultées sur Spotify, où Absolution trône régulièrement depuis sa réédition anniversaire. Ajoutez à cela une reconnaissance massive des pairs—Dream Theater, Radiohead, Placebo, pour ne citer qu’eux—et le sillon est durablement creusé.
Les membres de Muse et les collaborateurs majeurs derrière Absolution
Dans toute saga musicale, il y a les têtes d’affiche, et il y a ceux dont les doigts effleurent le chaos sans jamais mettre leur nom sous les feux. Matthew Bellamy, dont la voix stridente devient la signature du groupe, n’a pas volé sa place au panthéon des songwriters du XXIe siècle. Bellamy allie une technique pianistique héritée du conservatoire à un amour maladif du larsen et de la pédale fuzz—mélange rare chez un fils de guitariste pop (Georges Bellamy, The Tornados). Il compose, arrange, produit, et laisse sur chaque piste la trace, indélébile, de ses obsessions lyriques.
Chris Wolstenholme, oublié trop souvent dans les médias, pose sur la basse les fondations sur lesquelles Muse érige sa cathédrale sonore : puissants, percussifs, féroces. Sur l’album, son jeu groove entre la sauvagerie de John Deacon et la rigueur de Tony Levin. Dominic Howard, quant à lui, égrène les breaks percussifs à la limite de la rupture, oscillant entre violence et subtilité, notamment sur Apocalypse Please ou Stockholm Syndrome.
Côté production, Rich Costey, faiseur de miracles déjà passé par le studio de Rage Against the Machine, apporte la touche américaine, celle qui organise le chaos, laisse passer l’émotion brute mais recale tout sur la grille, pour éviter que le cirque ne tourne à la cacophonie. John Cornfield, Paul Reeve, et l’omniprésent Storm Thorgerson à la pochette, agissent comme les anges gardiens dans l’ombre. L’orchestre de Blackout, composé de musiciens classiques anonymes, insuffle à certains passages cette densité qui étranglait tout espoir de minimalisme. Ici, chaque contributeur, chaque assistant ingé-son, chaque machiniste du mixeur a pesé dans la balance du résultat final.
Rôles et anecdotes dans le processus créatif
On raconte que Bellamy, obsédé par la précision, pouvait refaire cent fois une prise pour isoler une attaque de synthé ou un effet de delay. Howard, plus flegmatique, improvisait parfois de nouveaux patterns en pleine nuit, forçant le groupe à réenregistrer la moitié d’un morceau à la dernière seconde. Wolstenholme, lui, apporte un sens du groove rarement salué, transcendant la frontière basse-guitare sur certains titres. Enfin, la participation ponctuelle d’arrangeurs de cordes ou d’ingénieurs californiens confère à l’album cette touche d’internationalité, hybride, entre vintage anglais et modernité synthétique.
Rééditions, remasters et versions alternatives : l’effet anniversaire
Les années défilent, et chaque décennie est le prétexte à une réévaluation. En novembre 2023, tout juste vingt ans après la première charge, Muse ressort Absolution en version remasterisée—le XX Anniversary. Pas de remix à la sauce opportuniste, mais un polissage numérique qui permet de redécouvrir chaque aspérité sous une lumière nouvelle. Cette version, saluée par les critiques et applaudie sur Spotify, propose quinze pistes originales gonflées à bloc, d’anciennes démos poussiéreuses, des versions lives capturées à Sydney, Berlin ou Vienne, et quelques perles isolées (Butterflies and Hurricanes en mode “vocals, keyboard and strings only”).
La magie de ce remaster tient à sa fidélité : il ne gomme rien de la violence originale, n’amplifie ni ne travestit. Il s’inscrit dans la continuité des tendances récentes à panthéoniser le patrimoine du rock, façon Black Album de Metallica ou OK Computer de Radiohead. Comme les reboots de franchise Marvel, mais avec de vraies tripes dessus. La durée totale approche les deux heures, de quoi rassasier les fanatiques collectionneurs et attiser la curiosité des nostalgiques qui regrettent encore la platine CD de la Clio de 2003.
Mais le plus intéressant réside dans le réagencement des morceaux, la possibilité de plonger dans les recoins inexplorés de la session studio. Démos de 2002, prises alternatives, captations live crépusculaires : tout est là pour cultiver le mythe, faire le pont entre les générations, et rappeler qu’Absolution ne s’écoute jamais deux fois de la même façon.
Événements associés et concerts marquants
À chaque réédition, Muse réactive la machine à frissonner sur scène. Les éditions anniversaire s’accompagnent souvent de tournées spéciales, de sets axés autour d’Absolution. Les fans, habillés pour l’occasion, recréent la fièvre du début des années 2000 dans un mélange d’hommage collectif et de communion électrique. L’édition limitée vinyle, épuisée en quelques heures, finit sur les étagères de collectionneurs intransigeants. Et les débats sur la fidélité du remaster enflamment chaque forum, du site officiel du groupe jusqu’aux commentaires de Origin of Symmetry.
Résultat : Absolution, vingt ans plus tard, suscite la même capacité à diviser, à sublimer, à envoûter, témoignant de sa place à part au panthéon du rock moderne.
Tableau détaillé des titres d’Absolution et informations techniques
| # | Titre | Auteur(s) | Compositeur(s) | Interprète(s) | Musiciens notables | Durée | Date d’enregistrement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | Matthew Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (piano, guitare), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 0:22 | 2002-2003 |
| 2 | Apocalypse Please | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (piano, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 4:12 | 2002-2003 |
| 3 | Time Is Running Out | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (guitare, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 3:56 | 2002-2003 |
| 4 | Sing for Absolution | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (piano, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 4:55 | 2002-2003 |
| 5 | Stockholm Syndrome | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (guitare, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 4:58 | 2002-2003 |
| 6 | Falling Away with You | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (guitare, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 4:39 | 2002-2003 |
| 7 | Interlude | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (claviers), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 0:37 | 2002-2003 |
| 8 | Hysteria | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (guitare, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 3:47 | 2002-2003 |
| 9 | Blackout | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (chant, guitare), orchestre 18 instruments | 4:22 | 2002-2003 |
| 10 | Butterflies and Hurricanes | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (piano, chant), arrang. cordes | 5:02 | 2002-2003 |
| 11 | The Small Print | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (guitare, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 3:28 | 2002-2003 |
| 12 | Fury (bonus UK/Japon) | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (guitare, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 5:00 | 2002-2003 |
| 13 | Endlessly | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (claviers, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 3:48 | 2002-2003 |
| 14 | Thoughts of a Dying Atheist | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (guitare, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 3:08 | 2002-2003 |
| 15 | Ruled by Secrecy | Bellamy | Bellamy | Muse | Bellamy (claviers, chant), Wolstenholme (basse), Howard (batterie) | 4:52 | 2002-2003 |
Conclusion sur l’héritage d’Absolution et trajectoire de Muse
Difficile de cerner la déflagration qu’Absolution a provoquée, sans sombrer dans la dithyrambe gratuite. Ce disque, rugueux, prétentieux, parfois agaçant, est la preuve que le rock anglais peut encore accoucher de monstres bifaces, à la fois machines à spectacle et laboratoires d’excès. Muse fait figure de survivant, naviguant au sein de Warner Music, EMI et même Universal Music, sans jamais se fondre dans la fadeur ambiante. En vingt-cinq ans, le groupe a su conserver son mordant, sa capacité à réinventer ses codes, et à transcender l’épreuve du temps, des médias et des modes.
Que l’on aime ou non, l’album reste un jalon pour toute une génération qui cherchait ses repères dans la désillusion du début de siècle. Les concerts, les rééditions, l’impact culturel—tout converge vers ce point de rupture qu’a constitué Absolution, un disque sans demi-mesure. Et pour ceux qui hésiteraient encore, il suffit d’observer la longévité du groupe sur Spotify et son omniprésence dans les classements Rock Sound pour saisir l’ampleur de l’héritage.
FAQ sur Absolution de Muse : questions fréquentes et réponses claires
Quel est le style musical principal de l’album Absolution de Muse ?
L’album Absolution de Muse mélange le rock alternatif, le progressif, des touches de hard rock et une orchestration proche du rock symphonique. Le groupe y développe un son puissant et lyrique, mêlant envolées de guitare, basse énergique, et arrangements de piano et de cordes.
Quelles critiques ont accueilli la sortie d’Absolution de Muse ?
À sa sortie, Absolution de Muse a reçu des critiques globalement positives. Q magazine, NME et Music Story ont salué son ambition et son identité sonore, tandis que certains médias comme AllMusic ou Rolling Stone ont nuancé leur avis, critiquant un certain manque de retenue dans la production.
Quelle est la place d’Absolution dans la discographie de Muse ?
Absolution occupe une position charnière : il marque l’affirmation du style Muse, la synthèse entre rock progressif, lyrique et moderne. Il précède Black Holes & Revelations et suit Origin of Symmetry, poursuivant l’évolution du groupe vers un rock toujours plus épique et travaillé.
Absolution de Muse a-t-il influencé d’autres artistes ou groupes ?
Oui, Absolution est reconnu comme une source d’inspiration majeure pour de nombreux groupes alternatifs et prog, avec notamment Dream Theater qui a cité Stockholm Syndrome lors de la création de Never Enough (album Octavarium). L’album a popularisé le mélange rock classique et orchestration moderne.
Existe-t-il une version remastérisée d’Absolution de Muse ?
Une édition remasterisée vingt ans après la sortie initiale, nommée Absolution XX Anniversary, a été publiée en novembre 2023. Elle propose les 15 pistes originales, des démos, lives et prises alternatives, offrant une nouvelle perspective sur ce classique du rock anglais.