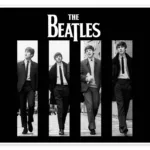L’histoire est racontée par les vainqueurs. Non. L’histoire est étudiée par les Historiens et c’est une matière parfois mouvante, comme toutes sciences sociales. L’histoire du rock est-elle aussi mouvante ? Possible. Elle est bruyante, c’est certain. Et dans le tumulte, sous le mur de décibels, certaines réalités, appellations peuvent se transformer, s’estomper ou finir par tomber dans l’oubli collectif. Noisy Pop.
Texte de Sylvain RUNBERG

My Bloody Valentine- Ode à la Noisy Pop
Noisy. Pop. De quoi s’agit-il ? Où ? Quand ? Comment ? Pour ma part, la connexion se fait au début des années 90 et principalement durant mes escapades londoniennes. Mais pour sortir cette expression des catacombes mémorielles où elle est tombée, intéressons-nous à un écho, une autre dénomination, qui est restée dans les mémoires et désormais partie prenante du rock contemporain : le Shoegazing.
En 2025, ce mouvement désigne un rock indie où la guitare est centrale, vibrante, hallucinée ou énervée, reverb, pédales, effets, tempo rapide ou lancinant, voix éthérées, parfois plus chantées et énergétiques. Les groupes concernés ? Une multitude.
Il y a les classiques, venus au départ d’Outre-Manche, à la conjonction de la fin des années 80 et du début des 90s : My bloody Valentine – forcément – puis Ride, Pale Saints, Lush, Teenage Fan Club qui font partie des élus reconnus à l’époque et qui pour certains ont opéré des revivals miraculeux à l’aube des années 2010, Slowdive en tête – nous y reviendrons –
Et puis des groupes menés par une nouvelle génération, parfois appelée Nu Gaze, à partir des années 2000/2010, The Pains Of Being Pure At Heart, A Place To Bury Stranger, M83, The Big Pink, The Horrors ou plus récemment WolfClub ou Resplandor avec des ramifications qui ont fini par s’étendre – étonnement – dans le Black Metal avec les Deaf Heaven, Alcest ou autres Liturgy.

The Big Pink – Ode à la Noisy Pop
Qui aurait pu imaginer la persistance et la résurgence, dans le monde entier, d’un genre que tout le monde pensait mort et enterré dès l’année 1992 ? À l’époque, soyons clair : personne. Moi y compris. Et pas qu’un peu.
1992, c’est l’année où je passais encore quelques semaines à Londres durant la période estivale, en quête de sensations musicales, vivant dans des squats à Elephant and Castle. Les salles de concert et les clubs de Camden Town, le festival de Reading. L’épicentre historique du mouvement « Shoegaze ». Que j’ai connu In Vivo. Et pourtant.
Les années 1990/1991 : j’écoutais déjà en boucle et depuis des années My Bloody Valentine, je dévorais la presse spécialisée, j’enchainais concert sur concert à Londres et ailleurs. Du hardcore au death-métal en passant par le hip hop et les alternatifs US de l’époque, le mal nommé Grunge, mais c’est un autre sujet. Pourtant, si à l’époque on m’avait demandé pourquoi j’aimais le Shoegaze, je vous aurais lancé en retour un regard interrogatif et amusé : le Shoe quoi ?
Revenons un peu en arrière encore. 1985. L’année où les écossais de The Jesus & Mary Chain sortent leur premier album, l’un des plus importants de l’histoire du rock : Psychocandy. Près de 40 ans plus tard, il est difficile d’imaginer le tremblement de terre sonique que ce disque a déclenché. Pour moi aussi, ce fut une révélation quand je découvre ce disque et ce groupe, révélation jamais démentie depuis.
Puisant leurs sons dans les 60s – Shangri La’s, Velvet Underground et Phil Spector – mais en l’enrobant d’une électricité punk où mélodie et pur bruit blanc se mêlent, les frères Reid allaient marquer de leur empreinte unique les décennies qui allaient suivre et tous les groupes qui allaient un jour se retrouver sous l’étiquette « shoegaze ». Avec des classiques instantanés comme « Just Like Honey », « My Little Underground » ou « You Trip Me Up » le groupe écossais se trouve catapulté dans les stratosphères du rock indé des années 80. Et le Shoegaze à l’époque ? Sans surprise, ce terme n’existe absolument pas.
Restons à Glasgow et intéressons-nous à un autre groupe qui n’a jamais connu le succès des JAMC mais qui leur est pourtant antérieur de quelques années, et les a sans conteste largement influencé : The Pastels. Mené par Stephen « Pastel » McRobbie à la guitare et au chant, accompagné par Annabel Wright (alias Aggi) – basse, chant et Katrina Mitchell – batterie, chant -, c’est un rayonnement de guitares pops saturées, de batterie hypnotique et de chants approximatifs aux paroles acidulées (“Train, Truck, Tractor” est imparable). The Pastels seront cités comme source d’inspiration par Nirvana, Sonic Youth ou…My Bloody Valentine. Rien que ça.
MBV donc. Les “My Bloody”. Irlandais menés par Kevin Shields et Bilinda Butcher, ils ne resteront pas lontemps dans l’ombre. Bien au contraire. Dés 1988 avec leur deuxième album Isnt Anything, leur musique à base de guitares aussi atmosphériques qu’énervées et de chant éthéré parfaitement maitrisé va forger leur marque de fabrique. En 1991, leur troisième album Loveless les propulse dans la catégorie des groupes qui comptent et dont l’influence va s’inscrire dans la durée. Mais là encore, toujours pas de Shoegaze en vue.

The Jesus and Mary Chain – Ode à la Noisy Pop
En réalité, dans le rock indie de la fin des années 80 et du début des années 90, ces trois groupes fondateurs, The Pastels, The Jesus and Mary Chain et My Bloody Valentine, s’ils partagent des approches similaires, sont aussi perçus comme des entités autonomes à la forte personnalité musicale. Concert jusqu’au-boutiste et provoc punkisante pour les Jesus, chaos amusé et décontraction bruyante pour The Pastels, approche plus intellectualisante, hypnotique et introspective pour les My Bloody Valentine… Ce qui les lie à l’époque est ce label commun, qui devient vite culte : Creation records, dirigé par Alan McGee. Label qui finira par publier les deux premiers albums d’un certain groupe appelé Oasis. On peut aussi rajouter les Londoniens de The Field Mice, qui officie de 1987 à 1991, tête de pont du label Sarah Record et dont le titre « Sensitive » est à lui seul un concentré de l’essence de cette famille musicale. Saturation et douceur mêlées. Et le terme qui est le plus fréquemment utilisé pour identifier ces précurseurs est… la Noisy Pop. Nous y voilà.
Le succès et l’influence de ces groupes va se concrétiser avec une vague de nouveaux prétendants partageant leur approche sonore : il y a bien entendu Lush, Ride, The Boo Radleys, Pale Saints, Teenage Fan Club et Slowdive. Et sur le moment, c’est moins le terme Noisy Pop qui retient l’attention que les labels sous lesquels officient ces groupes, d’où émanent une approche sonore et une esthétique particulière.
Deux entités surnagent : Creation Records et 4AD, sur lequel officient aussi les (futurs) légendaires américians Pixies et les écossais – encore une fois – de Cocteau Twins. Une apparté sur ces derniers. Les groupes “shoegaze” plus actuels les citent souvent comme une influence mais à l’époque ils ne sont pas associés à leurs autres compagnons sonores. On les englobe plutôt à à tort ou à raison – dans une certaine mouvance “new wave” éthérée.
En ce début des 90s, le mouvement s’internationalise : Europe, USA, Australie et les groupes affiliés – avec des approches parfois très différentes – se multiplient : Moose, The HeartThrobs, The Telescopes, Chapterhouse, Catherine Wheel, Power Of Dreams, Curve, Swervedriver, Medicine, c’est un véritable déluge sonore, où le passable côtoit le sublime, comme souvent dans ces cas-là.
L’excitation est à son comble entre 1990 et 1991 pour tous ces groupes et la presse musicale anglaise se montre alors leur meilleur soutien – Sounds, Melody Maker et le NME. Cette presse qui, dans une période où Internet et ses réseaux sociaux n’existent pas, font et défont encore des carrières dans le rock indie. Et puis arrive 1992…et tout va changer. Radicalement. Rapidement. Brutalement.
Ces groupes sont toujours aussi nombreux et en activité, les concerts s’enchainent mais un sentiment de trop plein s’installe, amplifié par cette presse musicale qui décide de tourner la page. Je me souviens avoir vu 3 fois Slowdive dans des festivals londoniens cet été 1991 et le sentiment de lassitude était déjà bien là pour une partie du public. Pas du tout la faute du groupe, mais le contexte était à la saturation…et pas celle des guitares.
L’ére des Nirvana, Soundgarden, L7 et Pearl Jam d’un côté et des Pulp, Blur et Oasis de l’autre était arrivée et la Noisy Pop va connaitre un déclin aussi brutal que rapide, alors même que ce terme ne s’est jamais vraiment imposé dans les médias musicaux. Non. Car c’est justement à ce moment que l’appellation Shoegaze va apparaitre et définir ces groupes. Pour le pire.
Une expression inventée par des journalistes anglais qui maintenant évoquent avec dédain cette scène qui selon leurs propres mots se célèbre elle-même avec ce leitmotive qui s’impose alors dans la presse anglaise : “the scene that celebrates itself”. Un revirement cynique à souhait de la part de nos chers plumes du NME et consorts, car ce sont bien eux qui les ont mis en avant en jouant parfois la surexposition deux années plus tôt.
Désormais, il est de bon ton de moquer ces musiciens qui ont tendance à fixer leurs chaussures sur scène – shoegazing donc – (en réalité, sur scène, c’était bien plus varié et variable selon les groupes). Implacable roue qui tourne et qui parfois broie. Au milieu des années 90, la scène s’effondre, aussi bien dans les ventes de disques que dans la fréquentation des concerts, les groupes se séparent et le terme shoegaze est devenu pour une partie de la presse spécialisée et du public une véritable insulte.
Il faudra attendre les années 2010 pour que la nouvelle génération d’artistes et le renouveau évoqués plus haut redonnent vie à ce genre musical. Son nom d’origine, tombé dans l’oubli, a été remplacé par une appellation désormais reconnue et valorisée : le shoegazing. Ce courant, autrefois considéré comme marginal, est aujourd’hui célébré pour de bonnes raisons — notamment par une nouvelle génération de fans.
Cela a été l’occasion pour moi, presque 30 ans plus tard, de revoir Slowdive sur scène, à Stockholm en 2018. Et de les apprécier enfin à leur juste valeur. En 2024, je revoyais aussi en concert The Jesus And Mary Chain, pour la troisième fois de ma vie. Sans surprise, ce fut encore une flamboyante et bruitiste cavalcade ultime.
À mon tour, exceptionnellement, de faire appel à cette sémantique qui dans le contexte fait sens : l’histoire est parfois racontée par les vainqueurs.
The Jesus And Mary Chain. Forever. Kings of Noisy Pop.